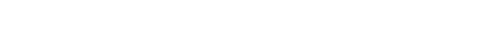Voici quelques témoignages, tant sur le camp central que sur certains Kommandos.
TÉMOIGNAGES SUR LE CAMP CENTRAL
La parole est donnée à une équipe d’anciens déportés présents à Mauthausen à l’automne 2000, entourés d’enseignants de plusieurs pays, d’inspecteurs généraux de l’Éducation nationale, d’universitaires français et autrichiens. La performance va se poursuivre en colloque à l’université de Linz (actes publiés, disponibles à l’Amicale*). Cette visite guidée est le point d’orgue d’une ambition mûrie durant la décennie précédente à l’occasion du « voyage des professeurs » proposé chaque année à des enseignants d’histoire, avec le soutien de leur association professionnelle (APHG, Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie) et grâce au financement du ministère. Plus de mille professeurs auront vécu cette expérience, contemporaine des réflexions conduites, plutôt sur le mode critique, par quelques historiens, sur L’ère du témoin (Annette Wieviorka, 1998).
Les témoignages qu’on va lire sont la transcription de ce qui fut dit, devant l’aréopage indiqué ci-dessus. La femme et les hommes qui s’expriment se livrent chacun à un exercice éprouvant, et n’ont, pour la majorité, aucune pratique de la parole publique solennisée par la circonstance. Pour nous aujourd’hui, à vingt ans de distance, la séquence n’a rien perdu de sa qualité : même, elle s’est confirmée dans sa dimension testimoniale.
Ce fut, l’automne 2000, la dernière circonstance où un groupe significatif de rescapés français et espagnols de Mauthausen accueillit, avec méthode et effort, sur le site du camp, une petite foule de plus jeunes pour tenter de faire comprendre, en délimitant nettement la place légitime et irremplaçable dévolue au « témoin ».
* Symposium I – Mauthausen : de la mémoire à la conscience européenne, Mauthausen-Linz (Autriche) 29, 30 et 31 octobre 2000, Amicale de Mauthausen, coll. Cahiers de Mauthausen
• Jean GAVARD et Ernest VINUREL : À l’approche du camp
• Pierre SAINT MACARY : Au portail de la forteresse
• Pierre LAIDET : Les douches
• Paul Le CAËR : La Quarantaine
• Pierre Serge CHOUMOFF : Le Bunker et la chambre à gaz
• Roger GOUFFAULT : Les Blocks
• Jean LAFFITTE : La Carrière
• Jaroslaw KRUZYNSKI : Le Revier (camp des malades)
• Pierre SAINT-MACARY et Juan DE DIEGO : Le secrétariat
• Marie-José CHOMBART DE LAUWE : Les femmes à Mauthausen
À l’approche du camp
Jean GAVARD et Ernest VINUREL
Jean GAVARD :
Chers amis, je voudrais vous donner quelques indications préalables sur le camp.
Quatre groupes de visite sont attendus à quatre points caractéristiques à l’intérieur du camp. Vous pourrez vous rendre compte de ce qui se passait, à travers les témoignages directs, essentiels pour vous, par des gens qui parleront de ce qu’ils avaient vu et connu. Or cette année, nous n’avons plus tous les déportés : certains ont disparu, d’autres sont fatigués.
Cette année, nous avons pensé rendre cette visite internationale et avec des gens jeunes, car nous cherchons des relais qui puissent transmettre après nous (c’est l’objet des ateliers), nous allons raisonner dans cette optique. Avec des membres de l’APHG, des professeurs étrangers, et des descendants, qui peuvent aider à prendre ce relais. Cette nouveauté est une étape très importante pour nous, pour maintenir la mémoire. Sous une forme probablement différente. Comment faire après nous ? Nous ne pouvons pas attendre que le dernier d’entre nous disparaisse.
Nous suivons la rive gauche du Danube.
Linz est une ville industrielle de 200 000 habitants, qui a joué un rôle important dans le développement de Mauthausen, au moins dans le deuxième temps de l’existence du camp.
Le premier temps est celui des carrières, et le deuxième, celui de l’utilisation systématique de la main d’œuvre pour l’industrie de guerre allemande.
Les KL de Mauthausen se sont rendus régulièrement à Linz. À la sortie des collines granitiques, l’existence de ce camp est axée sur ce phénomène géologique, cette masse de granit, il existait – antérieurement au camp – des carrières de granit dans toute la région, entre Mauthausen et Gusen…
… Je reprends la parole à l’approche de Mauthausen : notre but est de vous montrer comment les transports de déportés de toute l’Europe arrivaient à Mauthausen et comment était organisé le parcours, le transit (quel mot adéquat trouver ? ).
Ernest VINUREL :
Quelle est l’importance de la carrière près de Linz ? C’est la ville où Hitler est né… Le projet de Speer, l’architecte de Hitler, était de faire de Linz une ville-monument à la gloire du Führer. Ils avaient besoin de granit et de pierres. Linz aurait supplanté Vienne. On ne va pas déposer une couronne, mais il ne faut pas oublier que Hitler était de Linz !
La conservation de ce monument est due à l’utilisation du granit, contrairement aux autres camps en Allemagne. Origine du nom de Mauthausen: c’est la ville de l’« octroi ». Elle recevait une redevance pour les bateliers qui empruntaient le Danube.
Nous arrivons à la gare de Mauthausen, c’est par là qu’ont transité environ 200 000 déportés de l’Europe entière, par convois de cinquante à plusieurs centaines. Ici étaient ouverts les wagons qui débarquaient et que les SS « accueillaient » avec des chiens policiers ; les déportés, privés de leurs vêtements, sortaient nus des wagons. Le cheminement se faisait à pied, avec les chiens des SS. Le début du parcours est le même, mais il n’est plus possible de traverser le village en bus, nous allons quitter le chemin.
La population du village était témoin du passage des centaines de déportés, selon le témoignage de nos camarades et mon propre souvenir. L’attitude pouvait être très différente. Deux attitudes étaient possibles : les SS indiquaient à la population locale qu’arrivaient ici les pires criminels de l’Europe, ce qui entraînait des gestes malveillants et des jets de pierres. D’autres témoignages disent que certains habitants se signaient au passage des déportés.
Il y a environ quatre kilomètres entre la gare et le camp. À droite, nous allons quitter le chemin traditionnel pour arriver sur le plateau en face de la citadelle. Quelques-unes des villas ont été construites par les déportés, essentiellement des Espagnols.
En débouchant près de ces fermes à gauche, vous avez la première vision du camp qu’avaient les déportés…
Jean GAVARD, matricule 48 278 (Mauthausen, Gusen)
Ernest VINUREL, matricule 71 329 (Mauthausen, Melk)
↑ haut de page ↑
Au portail de la forteresse
Pierre SAINT MACARY
À cet instant où, pour la première fois, nous sommes tous réunis, puisque les Espagnols, les Italiens, les Allemands nous ont rejoints, je voudrais vous dire toute la joie et l’honneur que nous apporte cette journée. Dire que c’est d’abord l’œuvre de Michelle Rousseau-Rambaud et de Jean Gavard et que je ne suis qu’un porte-parole temporaire.
Il me revient, après le cheminement qui nous a conduits de la gare au camp, de vous dire dans quel sentiment nous étions en arrivant en ce lieu il y a plus de cinquante ans.
Même si nous avions une chemise d’emprunt, la chaussure d’un autre, le pantalon ou la veste d’un troisième ou d’un quatrième, nous étions dans la continuité de la prison et du camp de Compiègne. Compiègne qui avait été une sorte de rémission dans nos épreuves, mais cela nous ne l’avons su que bien plus tard.
Le train avait été une expérience très sévère, mais nous avions encore l’impression d’être un peu nous-mêmes, et puis nous sommes arrivés en vue de la forteresse et, avançant toujours, devant ce portail. Il était très grand ouvert et, pour la première fois, on nous comptait comme du bétail. Et là, nous avons su que nous allions changer d’état. Tout ce que nous étions auparavant, nous ne le serions plus à l’intérieur du camp. Pour nous, le passage de cette porte a été le lieu symbolique du passage de l’état d’hommes qui se croyaient encore un peu libres et qui, cette fois-ci, devenaient des Häftlinge, des numéros, des Stücke. À ce moment, nous avons perdu notre identité.
Nous allons entrer dans le camp…
En passant la porte, je vais aussi changer d’identité… je ne serai plus le témoin mais un peu l’historien, pour présenter le camp et organiser la suite de la visite.
Premièrement, en bon militaire, je vous indique le nord et je vous propose une description rapide des lieux.
Le camp était un domaine de quatre-vingts hectares qui commençait en bas de la colline avec les habitations des cadres SS ; puis le « grand cercle » des miradors qui enserrait la forteresse, le camp SS (casernements et bureaux – la zone actuelle des monuments), le camp des malades et, en bas, la carrière.
À l’intérieur de la muraille, en 1938-1940, il n’y avait que des baraques, la muraille et les tours ont été construites de 1938 à 1942, par les maçons espagnols. Quatre bâtiments en dur sur la droite ont été édifiés progressivement : la buanderie, les cuisines, le bunker et la « nouvelle infirmerie ». À gauche, dans la première enceinte, quinze baraques (il en reste trois) et, dans la deuxième enceinte, la Quarantaine puis, tout au fond, d’autres rangées de baraques qui ont été détruites : c’était le camp des détenus.
Quelle était la fonction de ce camp ? Mauthausen : ce sont 135 000 immatriculés, 200 000 détenus qui sont passés au total dont 120 000 environ sont morts. Peu sont restés longtemps dans ce camp central qui recevait et réexpédiait les hommes ailleurs, dans les Kommandos : Gusen, Loibl Pass, Ebensee, Vienne, Melk etc., soixante-dix camps annexes, d’importance et de durée variables.
Quand je suis arrivé en mai 1944, 37 800 personnes étaient immatriculées, 10 300 étaient au camp central. Parmi ces 10 300 personnes, 5 372 étaient au camp des malades, le reste était soit en quarantaine en train de « devenir » détenus (c’est en quarantaine que l’on touchait les tenues rayées et le numéro matricule), soit à l’important Kommando de la carrière, avec un effectif autour de 1 500, soit dans les services du camp qui occupaient un millier de personnes : les tailleurs, les cordonniers, les cuisiniers, etc.
En résumé, le camp central était un « petit camp » en effectif de travailleurs puisqu’il n’y avait qu’un seul Kommando productif, en dehors de la carrière, qui s’appelait « l’armement », situé dans une petite baraque près de la carrière, pour la firme Steyr.
Le camp est un réservoir qui se remplit par les convois arrivant des différents pays d’Europe (selon les ordres de la direction SS de Berlin et d’Oranienbourg) et se vide par les décès et les réexpéditions des effectifs dans les Kommandos. C’est ainsi que moi-même, j’ai été un peu moins de quinze jours en quarantaine et j’ai été réexpédié vers le Kommando de Melk, à une centaine de kilomètres vers Vienne.
Le camp a un cadre tragiquement majestueux mais c’est l’endroit où l’on « fabrique du déporté » à réexpédier dans différents Kommandos, c’est l’endroit où l’on récupère les morts pour les envoyer au crématoire.
Maintenant, les participants vont se scinder en quatre groupes autour des déportés qui vont les conduire vers les points de station où ils exposeront ce qu’il y a à savoir : aux douches, au Bunker et à la chambre à gaz, à la quarantaine et au Block témoin.
Ensuite, nous irons sur le site du Revier et celui de la carrière.
Général Pierre SAINT MACARY, matricule 63 125 (Mauthausen, Melk, Ebensee)
↑ haut de page ↑
Les douches
Pierre LAIDET
L’arrivée des déportés se fait par la porte d’entrée et aussitôt, si c’est un petit groupe, ils viennent directement sur cette place ; si c’est un grand convoi, ils passent entre les baraques et les cuisines pour venir se mettre en rang par cinq dans cette cour, au garde à vous.
Sur cette place, nous allons apprendre le premier supplice de cet univers concentrationnaire : l’attente. Nous attendrons pour aller à l’appel, nous attendrons à l’appel, nous attendrons pour aller au travail, nous attendrons pour aller à la nourriture, nous attendrons pour aller dormir. L’attente… mettez-vous ça dans la tête, la première maladie du déporté a été l’attente…
Pendant ce temps-là, qu’est-ce que nous faisons ? Tranquilles, au garde à vous, les SS derrière nous, nous essayons de découvrir les lieux, de comprendre où nous sommes arrivés ; nous découvrons ces murs de granit, surmontés de cinq rangs de barbelés électrifiés, nous découvrons ces miradors qui sont gigantesques avec des grosses mitrailleuses dans chacun, nous sommes sous haute surveillance.
Pendant cette attente, nous recevons des coups : ce sont les SS qui donnent des coups de crosse, nous n’avons rien fait. Pourquoi nous cognent-ils ? Nous finissons par comprendre que ces coups, c’est pour nous montrer qu’ils ont l’autorité suprême, que nous leur devons l’obéissance absolue, que nous devons tout accepter, que nous ne sommes plus nous-mêmes, nous sommes leurs Stücke (Stück se traduit en français par « morceau »), on ne compte pas les hommes, on compte ein Stück. On va essayer de comprendre…
On venait de quitter les wagons, on espérait avoir un peu d’eau en arrivant, il n’y a pas d’eau, il n’y a pas d’eau… petit à petit, les Kapos commencent à circuler autour de nous ; alors on leur demande de l’eau : « il n’y a pas de problème, tu as de l’argent ? une chevalière en or ? une alliance ? ».
On n’a rien, donc on ne boit pas… et celui qui avait conservé une alliance, qui a voulu la donner pour avoir un verre d’eau n’a jamais revu ni le Kapo ni le verre d’eau…
Nous attendions de passer aux douches, en nous disant : on va pouvoir boire. Mais les heures passent, l’attente se prolonge, pour nous cela a duré onze heures…
Et nous sommes devant ce mur où nous découvrons des anneaux scellés : et à ces anneaux il y a toujours un homme attaché, ou plusieurs hommes, des hommes qui sont désignés au hasard pour mourir… ils n’ont rien fait de spécial… les Kapos reçoivent l’ordre des SS de les arroser, et le matin ce sont des blocs de glace qui sont scellés au mur…
À ce carrefour, on est à poil, on donne notre nom. On va enfin découvrir la douche et le bonheur ?…
Nous arrivons dans cette première salle, nous nous trouvons en face d’hommes en blanc, ces hommes qui ont l’air de vouloir jouer le rôle de médecins sont équipés d’un seul instrument : une spatule en bois qu’ils tiennent à la main. Ils font semblant de nous ausculter, mais surtout leur gros travail, c’est de nous ouvrir la bouche pour savoir si nous avons des dents en or… nous recevons le chiffre 1, 2 ou 3 sur la poitrine. Les numéros 1 et 2 sont allés aux douches, les numéros 3, nous ne les avons jamais revus…
Le deuxième numéro que nous avons sur le ventre, c’est le numéro du coiffeur auquel nous devons nous adresser.
Nous passons dans la salle de douche : l’éclairage est très faible, cette salle carrée est contournée par un trottoir, et sur ce trottoir on va trouver les coiffeurs avec leur numéro sur le mur. On se présente chacun son tour : d’un coup de tondeuse ils nous décoiffent ; avec le rasoir, ils nous passent tout le système pileux sans trop de précaution ; une fois terminé, ils ont à côté d’eux un seau avec du grésil et un pinceau et ils nous badigeonnent de la tête aux pieds pour qu’on n’ait pas de parasites. C’est le moment de joie car nous arrivons vite sous la douche et nous nous disons que nous allons pouvoir boire. Mais ce n’est pas possible de boire parce qu’on va passer de la vapeur d’eau à l’eau glacée, à l’eau froide, c’est un choc thermique permanent, on a mal, on veut repartir sur les trottoirs mais ce sont les SS cette fois qui y sont et c’est la ruée pour nous remettre dans l’arène, c’est le grand jeu… nous n’avons pas bu… ça a duré trois ou cinq minutes…
Une fois cette opération terminée, on nous fait rentrer dans cette salle, on nous donne une chemise, un caleçon, une paire de claquettes à semelle de bois avec une lanière ; nous les garderons tout notre temps de déportation.
On sort, on rejoint la place d’appel. Nous nous retrouvons tous, mais on se sent seul car personne ne nous reconnaît, on a changé, on est devenu des monstres, un regard… on part en quarantaine.
Pierre LAIDET, matricule 62 636 (Mauthausen, Melk, Ebensee)
↑ haut de page ↑
La Quarantaine
Paul LE CAËR
En 1941, il n’y avait pas de mur ici, les enceintes avec des murs n’ont été construites qu’en 1944. Cet endroit qu’on appelle le camp de quarantaine a été créé avant l’infirmerie du camp, il y avait cinq baraques. C’était l’infirmerie, les Blocks 16, 17, 18, 19, et 20. Le block 20, le plus mauvais Block où j’ai vécu, était le Block des « chiasseux », c’est devenu le Block de quarantaine en 1944.
Dans le Block 16, on a fait des essais de nourriture à base de cellulose. Notre ami Jean Laffitte est resté un an en quarantaine ici, en se nourrissant de cette saloperie mais on ne l’empêchait pas d’aller travailler à la carrière… ceux qui mangeaient cette mixture à base de cellulose, devenaient gonflés et atoniques. De ces trois cents qui ont subi ce régime, il y a aujourd’hui quatre survivants.
Je vous rappelle que nous étions habillés d’une chemise, d’un caleçon, avec des « babouches » en bois. Nous restions en équilibre pendant les appels sur ces pierres tranchantes… la turpitude des nazis pour nous déshumaniser était sans limite… il n’était pas question de se laver… devant la dégénérescence des individus, chacun est vite tombé dans l’égoïsme… on a perdu la personnalité humaine, nous n’étions plus que des « mauvais numéros »… Les mauvais numéros, c’étaient les personnes âgées, elles qui avaient connu la vie, la famille… ils n’écoutaient même plus les conseils… nous les jeunes, c’était plus facile, on n’avait personne derrière… Les jeunes raflés à la sortie du cinéma, les jeunes de Nancy, de Villeurbanne que j’ai connus n’avaient pas de motivation non plus… Ils ne comprenaient pas… les résistants comprenaient mieux… Ils savaient pourquoi ils étaient là… Cette différence psychologique a joué sur le physiologique… nous avons vécu comme des bêtes…
Dans ces baraques, il y avait un coin pour les toilettes, le lavabo, ensuite un grand espace réservé à ces seigneurs Kapos allemands et chefs de Block et on mettait huit cents bonshommes entassés comme des sardines tête bêche. J’avais souvent des grands pieds de Russe dans ma bouche… Quand on se levait pour aller faire pipi, on ne retrouvait pas sa place…
Ici on a essayé de conserver un peu de culture, de faire trois ou quatre conférences : on a eu une conférence d’un journaliste de France-Soir sur Cayenne, c’est risible… sa conclusion a été : Cayenne était beaucoup mieux qu’ici… Il m’a dit qu’il était en camp de concentration parce que Goering voulait ses trophées de chasse qu’il avait rapportés de ses voyages, je n’ai jamais vérifié si c’était vrai…
Ici nous allons devenir des numéros, c’est tout…
Pour survivre, il fallait observer…
En hiver, on faisait « la boule », on s’enroulait et celui qui était au milieu sortait, c’était le mouvement perpétuel…
Derrière le Block 20, il y avait la butte des fusillés, on entendait le bruit des balles, on voyait la charrette passer avec les corps ensanglantés, en direction du four crématoire.
En 1944, on a construit ce mur de 2 m 50, avec un mirador ici, un autre ici, un autre entre les Blocks 19 et 20.
Un jour, on amène mille Russes, des soldats non immatriculés, destinés à mourir d’une balle dans la tête, des détenus « K » [Kügel, en allemand, signifie « balle »]. Cinq cents étaient déjà grabataires.
Le 20 janvier 1945, les officiers russes décident de s’échapper. Ils avaient un plan de bataille : le 2 février, à 0h50 du matin, -5 °C, 10 cm de neige, ils attaquent le mirador, là, ils balancent des couvertures mouillées pour faire sauter les barbelés électrifiés ; avec l’extincteur et des cailloux, ils réussissent à prendre les mitrailleuses et ils sont maîtres du coin… ils partent à trois cents, trois cent cinquante… aussitôt la sirène dans tous les alentours est déclenchée… c’est la chasse à l’homme, la chasse « aux lièvres »… Les paysans avec les chiens, les gendarmes, les jeunesses hitlériennes, les réservistes, etc. cherchent jour et nuit… Les prisonniers repris ont tous été exécutés… Il y a eu deux survivants sauvés par une Autrichienne qui les a cachés jusqu’à la fin de la guerre… un petit bonhomme, un commandant aviateur, parti en direction du nord vers les maquis tchèques, a survécu en mangeant des racines ; dans son évasion, il a tué un soldat de la Wermacht, s’est habillé avec l’uniforme et a vivoté de rapines ; il est fait prisonnier des Américains, il est resté trois ans prisonnier car il n’a pas osé dire qu’il était Russe, il n’a rien dit. Mais ses camarades qui ont appris son histoire, on ne sait comment, ont décidé de le rapatrier chez lui avec les honneurs… c’est la seule personne que j’ai revue…
Paul LE CAËR, matricule 27 008 (Mauthausen, Wiener Neustadt, Redl Zipf)
↑ haut de page ↑
Le Bunker
Pierre Serge CHOUMOFF
Les victimes arrivaient directement le long du mur et seuls 10 % de ceux qui ont passé ce porche en sont ressortis vivants. Ces 10 % ont été ceux qui travaillaient au fonctionnement de la chambre à gaz et du four crématoire.
Il y a trente ans que je m’occupe de la chambre à gaz : car une thèse d’histoire présentée en Sorbonne en 1968 niait l’existence de la chambre à gaz de Mauthausen [ndlr : Olga Wormser, Le Système concentrationnaire nazi (1933-1945), thèse de doctorat de l’université de Paris (1968), Paris, PUF, 1968].
La cour était également un lieu d’exécution. J’ai interrogé notamment deux témoins polonais, retrouvés en 1985 et interrogés ici sur les lieux mêmes : lorsqu’il y avait des grands groupes de victimes, c’est ici qu’elles se déshabillaient, les fenêtres étaient peintes et les prisonniers avaient gratté un petit coin de la fenêtre : par là, ils pouvaient se rendre compte. Les futures victimes entraient par cet escalier (déshabillées si elles étaient nombreuses ou non déshabillées si c’était des petits groupes). Elles passaient un semblant de visite médicale, de façon à inspirer confiance, en réalité pour repérer surtout les dents en or. Une fois qu’elles étaient examinées rapidement, on les faisait passer par là, l’antichambre de la chambre à gaz. Dans cette petite pièce que j’ai appelée « la pièce de génération du gaz Zyklon », ici, il y avait l’appareillage que l’on a enlevé maintenant (mais une photo a été prise par cet Américain, Jack Taylor). C’est dans cet appareil que l’on mettait les boîtes de Zyklon B, chauffé par des briques mises sous l’appareil (le Zyklon B a besoin de 27 °C pour se sublimer). Ce gaz était introduit dans la chambre à gaz par un petit tuyau. Le hublot de la porte était important car, pour toute exécution, il y avait un médecin SS présent en principe, on regardait si les gaz avaient agi, également en introduisant un petit papier sensible.
J’attire votre attention : c’est une installation de douches, il s’agit de douches réelles ; à Mauthausen, les douches sont réelles, toute chambre à gaz a besoin d’une alimentation en eau pour nettoyer les locaux. Regardez bien cette installation qui est restée telle quelle. Ce qui a disparu, c’est l’introduction du gaz qui était là, pour neuf personnes par mètre carré.
La sortie se faisait très rationnellement. On ouvrait cette porte-ci parce qu’elle était en direction du four crématoire. La pièce qui est associée ici est la pièce d’exécution de Mauthausen. Jusqu’à la fin de 1943, des fusillades avaient lieu à l’aplomb du Block 20 (on vous en parlera), mais à partir de 1943, la plupart des exécutions ont eu lieu ici, soit par balle dans la nuque, soit par pendaison.
Dans le jugement du SS Roth, Kommandoführer de la chambre à gaz et du four crématoire pendant cinq ans, il a été reconnu coupable d’avoir exécuté, lui-même, dans la chambre à gaz, plus de mille six cents personnes, d’en avoir pendu une centaine, d’en avoir tué par balle dans la nuque cinq cents. Il n’y a aucune confusion possible.
Je voudrais vous dire combien les attendus du procès sont fondamentaux pour nous, parce que dans le cas de Mauthausen, il n’est jamais marqué dans les documents des nazis que quelqu’un a été gazé (sauf dans un cas) ; en général c’est simplement indiqué « exécuté », « fusillé », « pendu » mais jamais « par gaz » ; or, pour juger quelqu’un pour gazage, il fallait que la justice le prouve. Il a fallu des témoignages convergents.
Des Polonais ont témoigné qu’ils restaient postés ici, lors des exécutions par balle, pour nettoyer avant de faire rentrer la prochaine victime.
Ce four crématoire a fonctionné depuis le début, depuis 1940 jusqu’à 1945. Un deuxième four crématoire a fonctionné au mazout, puis faute de mazout il a été enlevé. Il y en a eu un troisième.
Le nombre de cadavres incinérés à Mauthausen est de l’ordre de soixante seize mille. Aucun corps n’était brûlé sans qu’il y ait une décharge du SS, on a trouvé la comptabilité des détenus matriculés.
Dans un tel four, on pouvait mettre jusqu’à quatre cadavres.
En 1945, il y a eu beaucoup de fosses communes, mais jamais pour les personnes exécutées, qui étaient incinérées.
Sous le musée actuel, il y a d’immenses salles qui servaient aux expériences médicales…
Pierre Serge CHOUMOFF, matricule 15 014 puis 47 836 (Mauthausen, Gusen I)
↑ haut de page ↑
Les Blocks
Roger GOUFFAULT
Cette baraque est d’origine.
La seule chose inexacte, ce sont les lits. En réalité, ils étaient à trois étages et non deux comme ici. J’avais 18 ans, je couchais en haut, la personne âgée était en bas. J’y suis passé en 1943. Au début, on couchait à deux par lit, ça faisait six personnes dans un châlit. Mais on n’était pas six Français (il y avait vingt à vingt-trois nationalités ici).
Le premier grave problème ici, c’était la langue allemande, quand on arrivait. Les premiers mots d’allemand qu’il fallait apprendre, c’était son matricule.
La première trempe que j’ai prise c’est sur la place d’appel, au garde à vous : je n’ai pas répondu à mon matricule 34 534, j’ai pris une bonne trempe, je suis resté assommé ; j’avais 18 ans, j’ai appris mon numéro dans la nuit même, j’ai passé la nuit blanche à l’apprendre…
J’ai eu la chance, si l’on peut dire, de coucher dans la baraque 9, de coucher avec un Allemand qui était dans les camps depuis 1934, il m’a appris quelques mots chaque jour… au bout d’un mois, je connaissais les principaux mots…
C’était la vie des hommes entre hommes…
Le chef de Block était un « droit commun », les Kapos étaient des criminels en puissance. Pour donner une idée de leur sadisme, je peux vous dire que toutes les nuits ils défaisaient les fenêtres, il y avait des courants d’air… on couchait à deux, ensuite à trois, à quatre par lits, tête-bêche.
Le principe ici : un pou c’est ta mort, si on trouvait un pou sur vous on vous tuait. Ils faisaient le contrôle des poux ; s’ils en trouvaient un, ils donnaient vingt-cinq coups de trique sur les reins. Quelquefois doublés, pourquoi ? Parce que le camarade qui recevait les coups devait les compter en allemand et comme le Français ne savait pas l’allemand… Il n’était pas tué sur le coup mais le lendemain il ne pouvait pas travailler, ses jours étaient comptés… À aucun moment vous ne saviez à quel moment votre vie pouvait s’arrêter… C’était atroce…
Le problème d’hygiène : si un homme avait un oubli, c’était celui au-dessous qui prenait… on ne peut pas décrire… L’homme qui est en train de mourir, l’homme qui souffre, l’homme qui a un flegmon, l’homme qui a la diarrhée… on ne peut décrire…
Ici, il y avait le « Stuben » qui s’occupait du nettoyage, le « Friseur » qui nous rasait avec la tondeuse…
De l’autre côté, il y avait la distribution du pain, de nourriture. Les conditions de vie ont continuellement changé : au début pour moi, en 1943, on avait un pain coupé en quatre, ensuite ce pain a été coupé de plus en plus petit jusqu’à vingt-quatre parts… ce n’était pas du pain, c’était tout ce qu’on veut mais pas du pain…
Le vieux que j’étais, pas en âge mais en mois de détention, a vu son estomac se rétrécir tout doucement et quand le très grand rationnement est arrivé, je n’étais pas en état de manger. Mais le camarade qui est arrivé de France en 1944, avec ses quatre-vingt-dix kilos est mort de faim très rapidement… au bout d’un mois, deux mois, il est mort. C’est une raison de mortalité…
Moi, je dois la vie à toutes les nationalités, j’ai été sauvé par la solidarité et après, à mon tour, j’en ai sauvé car je connaissais l’allemand.
Le matricule devait toujours être apparent…
Les conditions de vie changeaient d’un Block à l’autre, ça dépendait du chef de Block ; dans le Block 17, c’était un éthéromane, on l’appelait « Popeye », un tueur, il prenait sa bouteille d’éther, il était fou et il tuait… On côtoyait toutes les espèces d’hommes…
Huit mètres sur douze = quatre-vingt-seize mètres carrés de surface : on couchait à trois cents pendant la quarantaine, on couchait en sardines.
Ici, c’était les « toilettes ». On n’avait pas le temps d’uriner, de faire ses besoins… il fallait penser aux camarades qui avaient la diarrhée, c’était la mort… j’ai vu tuer un gars ici parce qu’il ne sortait pas assez vite, un autre s’est pendu ici… c’était un coin atroce… Il n’y avait qu’un seul moyen de supprimer la diarrhée, c’était de manger du charbon de bois, donc il fallait en ramener de la forge… ce n’était possible que grâce à la solidarité… grâce à la chaîne humaine de solidarité… Un homme isolé ne vivait que trois jours ici…
Pour vous laver, vous deviez arriver ici torse nu, le principe était d’arriver à attraper un peu d’eau… un coup d’eau, trois cents personnes en un quart d’heure… il fallait arriver au lavabo… il fallait rester toujours attentif… au coup de matraque… toujours guetter le Kapo…
Très rarement, on nous a changé nos chemises et les caleçons pour être désinfectés à l’air chaud, mais on ne récupérait pas les mêmes, on récupérait une chemise trop petite, trop grande, avec des excréments séchés, du pus…
On essayait de nous avilir, de faire de nous une bête… et malgré tout on est resté des êtres humains…
Roger GOUFFAULT, matricule 34 534 (Mauthausen, Ebensee)
↑ haut de page ↑
La carrière
Jean LAFFITTE
Vous êtes ici dans la carrière de Mauthausen, de son vrai nom Wienergraben.
Pour les anciens qui ont travaillé là, il n’est pas besoin d’y revenir pour en trouver les images, mais pour vous il faut imaginer. Alors imaginez…
À l’époque, cet horizon de verdure qui aujourd’hui nous entoure, à part une éclaircie là-bas sur un coin de paysage, à part quelque végétation dans les lieux interdits ou inaccessibles, était un horizon de pierre et, sur le sol où vous marchez, l’herbe ne poussait pas, ne poussait plus…
Imaginez ces falaises en arc de cercle, à ma droite, hautes de trente mètres et plus, tranchées à vif, laissant apparaître par failles successives les diverses couleurs du granit…
Imaginez ces trois étangs d’aujourd’hui, où j’ai vu tout à l’heure nager des poissons, en des fosses profondes et vides au fond desquelles s’éboulaient les rochers et les pierres. Des hommes y travaillaient…
Imaginez, là derrière moi, cette petite colline que nous appelions entre nous la petite montagne. Il n’y avait que quelques arbustes et un énorme buisson là-haut suspendu dans le vide…
Imaginez, tout autour là-bas, plus loin, ces petites collines, éventrées, avec un sol dénudé à leurs pieds… imaginez cela…
Chaque matin, mille cinq cents hommes, deux mille, plus ou moins selon les époques, descendaient là. Nous partions du camp en une immense colonne par cinq, échelonnés par centaines, les bras collés au corps, marchant au pas cadencé comme des automates, enlevant au passage devant la grand porte notre calot de forçat pour saluer les officiers SS, défilant ensuite dans les camps SS avec de part et d’autre une rangée de soldats tenant des chiens en laisse ou l’arme à la bretelle… Puis venait la descente, dans le petit chemin que vous avez suivi pour arriver à l’escalier, elle se faisait au pas de course, sous les coups de bâtons et les hurlements des SS… Et c’était la plongée dans l’escalier, toujours cinq par cinq, avec nos galoches de bois claquant sur les pierres… Parfois il y avait des drames dans cet escalier mais à mon sens, selon mon expérience tout au moins, la descente n’était pas le plus dur.
La première fois que j’ai descendu ces marches, il m’a semblé descendre dans le cratère d’un volcan, un immense cratère. C’était à la fois grandiose et terrible, avec tout en haut, sur les crêtes, comme un immense cercle entourant cet espace, une haute clôture de barbelés et des miradors, perchés de loin en loin, sur quatre poteaux de sapin. Et bien sûr, dans chaque mirador, un soldat avec le fusil mitrailleur toujours prêt à tirer.
Au fond de la carrière, il y avait encore un appel qui, cette fois, se faisait très vite car il ne fallait pas perdre de temps. Il s’effectuait presque au pas de course par le Kommandotführer SS Spatzneger que les Français appelaient « Spatz » et les Espagnols « El Seco », désacralisant du même coup ce terrible tueur.
Alors là, pendant les quelques minutes que durait cet appel, il y avait un moment prodigieux, un moment extraordinaire… Sur le buisson là-haut, on entendait un oiseau qui chantait. Je n’ai jamais entendu d’oiseau chanter à Mauthausen autre que celui-là. Et tout à l’heure, les oiseaux, beaucoup plus nombreux, chantaient à nouveau.
Mais très vite, c’était la course au travail, la course vers les Kommandos pour s’emparer de l’outil : pelle, pioche, pic, drague, n’importe quoi, car autrement il fallait travailler à mains nues ; les uns couraient vers les fosses pour ramasser des pierres qu’un pont transbordeur traversant la carrière et attaché là-haut par des câbles immenses enlevait sur un plateau de bois qui descendait au fond. D’autres couraient vers les baraques, les ateliers ou encore plus loin, vers le moulin à pierre qui se dressait là-bas tout noir, dans le fond…
Puis commençait ce travail dans la carrière. Dans un bruit infernal, un tournoiement continuel, le bruit des wagonnets qui s’entrechoquaient les uns contre les autres, le vrombissement des camions qu’il fallait charger à toute vitesse, le bruit des marteaux-piqueurs tenus par les hommes qui tremblaient, échelonnés un peu partout sur les roches pour percer la falaise, le halètement des compresseurs placés un peu plus loin, nous masquant toutes les issues, de sorte que, ayant travaillé là près d’un an, je n’ai jamais vu une sortie de cette carrière. Et c’était comme cela du matin très tôt jusqu’au soir, jusqu’au coucher du soleil parfois très beau…
Ainsi était le bagne, car ce cratère était un bagne, où il fallait travailler sans relâche sous peine d’être battu à mort, sous le risque de recevoir une pierre lancée de là-haut. Il fallait surtout ne pas se faire surprendre dans un moment de repos où on essayait d’échapper à sa fatigue, à la rudesse du travail…
C’était cela la carrière. On y travaillait par tous temps : le froid, la neige… Le plus terrible était la pluie avec nos vêtements de forçat en tissu spongieux qui ne séchaient pas, nous revenions mouillés le lendemain. Une journée de pluie était ici terrible…
À midi, la sirène sonnait, les hommes couraient vers le moulin pour recevoir leur louche de soupe dans la gamelle que nous portions toujours avec nous, une louche de soupe presque invariable, faite de rutabagas, heureux si nous trouvions quelquefois une pomme de terre ou un morceau d’os qu’on mettait tout le jour à ronger et pendant que nous mangions cette soupe debout, les Meister autrichiens faisaient ici sauter les rochers à la dynamite, d’autres pierres s’éboulaient et le travail recommençait jusqu’au soir.
Heureux si dans l’intervalle on avait échappé à l’une des terribles corvées qui se faisaient ici à la carrière : il fallait remonter les morts, il fallait remonter les bouteillons vides de soupe de cinquante litres. C’était dur et plus dur encore chaque jour, il fallait aussi monter les tinettes d’excréments. Il y en avait sept à mon époque, nous les montions à quatre dans cet escalier pour aller fumer les jardins des SS aménagés sous les remparts…
C’était cela, cette carrière au temps du bagne, au temps où nous l’avons connue. Maintenant il en reste cet espace, toujours grandiose. Il en reste ce rocher à pic que vous voyez. Les SS l’appelaient « le mur des parachutistes » par dérision. Ils y ont fait sauter des hommes dans le vide, qui s’écrasaient en bas sur les pierres comme des pantins disloqués ; l’un des premiers Kommandos de juifs ramenés d’Amsterdam au mois d’août 1942, les Espagnols en furent témoins, a été exterminé par ce moyen.
Et puis, il reste l’escalier, l’escalier qui se dresse et qui demeure comme un monument. Bien sûr, certains des nôtres regrettent qu’il ait été si bien reconstruit avec des pierres si bien ajustées, mais il a aujourd’hui 186 marches et tous les anciens peuvent aussi vous assurer qu’à l’époque du bagne, il avait aussi 186 marches. Ce que nous pouvons vous dire, c’est que le plus dur, dans cet escalier, c’était la montée. La montée du soir, après le dernier appel, où quelquefois bien sûr il manquait des hommes, la montée de cet escalier que l’on remontait à nouveau dans une immense colonne, toujours par rangs de cinq.
Montaient les premiers les Kapos, les forts, ceux qui pouvaient s’imposer, ceux qui prenaient les meilleures places devant, repoussant les autres, les plus faibles, derrière, toujours derrière, alors commençait le soir, cette fameuse montée de l’escalier… Ceux qui restaient derrière voyaient monter les premiers, toujours cinq par cinq, on avait l’impression qu’ils montaient doucement, on se disait « ce soir ça ne montera peut-être pas trop vite ». Heureux si, ce soir-là, on montait l’escalier sans avoir comme très souvent une pierre à l’épaule, comme dernier fardeau de la journée. On les voyait monter doucement, mais ces premières centaines, ces hommes de tête, en arrivant en haut, commençaient à marcher plus vite sur le petit chemin. Alors derrière, il fallait suivre… il fallait les rattraper et c’est à ce moment que les SS, postés en file sur le mur de gauche, commençaient à cogner pour que l’on monte toujours plus vite. Et cette montée d’escalier était une épreuve terrible.
Il fallait apprendre à respirer, il fallait regarder où l’on mettait ses pieds. Malheur à celui qui perdrait un soulier ou son sabot, malheur à celui qui faisait tomber sa gamelle, malheur à celui qui tombait… de sorte que, lorsqu’on arrivait en haut, on pouvait dire fièrement, à l’exemple de nos camarades espagnols « una victoria màs » [une victoire de plus], c’est-à-dire un jour de vie…
Nulle statistique ne pourra vous dire combien d’hommes ont connu ici en descendant leur dernier matin, combien d’hommes y ont vu le soir leur dernier coucher de soleil.
Il y a eu des morts dans cet escalier, il y en a eu beaucoup et encore davantage, des suites de l’avoir trop monté, du dernier effort qu’il leur a fallu faire après une journée de bagne et qui a fait que le lendemain ils n’ont pas pu repartir, ils n’ont pas pu continuer. De ceux-là, aucun témoin ne peut vous dire le nombre, mais ce dont nous pouvons vous assurer, ce que je peux vous dire, c’est que sur chaque marche, je dis bien chaque marche de cet escalier, il est tombé du sang…
Vous allez le remonter, faites-le avec respect.
Je vous remercie.
Jean LAFFITTE, matricule 25 519 (Mauthausen, Ebensee)
↑ haut de page ↑
Le Revier (camp des malades)
Jaroslaw KRUZYNSKI
Je suis arrivé au camp central le 18 avril 1943, le dimanche des Rameaux.
L’Autriche est un pays au climat continental, l’année dernière (1996) à pareille époque nous étions dans la neige.
On passait nos journées dans la cour du Block et au bout de quinze jours, j’avais une fièvre de cheval, un abcès à la gorge. Pour moi, la question était résolue, je me suis donc retrouvé dans ce qu’on appelait le Revier.
À ce moment-là, le Revier était composé d’une baraque de cuisine, de trois baraques de malades n° 1, 2, 3 et une petite baraque n° 4 où logeaient des médecins et une petite partie qui servait de toilettes. Je me suis trouvé dans la baraque Block 2, elle était à peu près de la même dimension que celles qui existent encore en haut. À ses deux extrémités, il y avait deux portes, à l’entrée de droite, un petit cagibi avec des bacs qui servaient pour les besoins, à l’autre extrémité un autre cagibi pour le chef de Block, droit commun allemand un peu sadique, il avait pour caractéristique de n’être pas gros et gras comme tous les autres car il était tuberculeux au dernier degré et il est mort très rapidement.
Nous avions des châlits à trois niveaux et on couchait à deux, trois, ou quatre, par châlit.
Les gens étaient classés par catégorie de maladies : au début du Block, il y avait les tuberculeux, les gens crachaient le sang, il y avait ensuite les syphilitiques et les maladies de la gorge.
La distribution de soupe : les services généraux apportaient avec eux des gamelles, on mettait la soupe là-dedans, les tuberculeux lapaient la soupe, on remettait de la soupe sans rien laver, bien entendu, les syphilitiques lapaient à leur tour… au bout de quelque temps j’ai compris que l’affaire était cuite pour moi… et j’ai eu une chance extraordinaire, la même qu’a eue Primo Levi… il raconte cela dans Si c’est un homme. Primo Levi était dans un Kommando très dur et un jour on l’a mis dans un laboratoire d’analyses car il était ingénieur chimiste, moi j’ai eu exactement la même chance.
Un jour on a demandé des physiciens, des chimistes, des botanistes, je me suis dit « foutu pour foutu, j’y vais… ». Je me suis inscrit comme mathématicien et comme chimiste, j’avais un certificat de mathématique générale et j’avais déjà travaillé pendant plus d’un an et demi dans un laboratoire de chimie. On nous a rassemblés, une trentaine ; est venu le capitaine SS médecin, le médecin Muller de Berlin, il a discuté et en a choisi une douzaine : trois Tchèques (dont London parle dans l’Aveu), trois Polonais, deux Yougoslaves, un Belge et deux jeunes Français, un étudiant en médecine de Grenoble et moi. On nous a ramenés à l’infirmerie SS, (quand vous sortez du camp, vous avez à gauche le bâtiment en dur qui est la Kommandantur, à droite il y avait l’infirmerie SS) et, là, on nous a donné la dernière pièce du fond pour faire des analyses de vitamines.
Les expériences consistaient à faire des analyses de vitamines pour chaque nationalité, et pour plusieurs catégories médicales de gens : les uns avaient la nourriture « normale » du camp, d’autres avaient trois soupes au lieu d’une, d’autres avaient une espèce de farine, et il s’agissait de faire les analyses de vitamines. Ceci a duré deux ou trois mois. J’avoue très franchement que cela m’a sauvé la vie car, premièrement, nous étions à l’infirmerie SS, et nous avions un travail pas très compliqué et, deuxièmement, parce que nous étions, je dois le dire, nourris correctement pour une raison extrêmement simple : à l’infirmerie SS, les médecins qui soignaient les SS étaient des déportés, il y avait un médecin tchèque, Podlavar, un médecin français, Fichez, et Ginesta, un Espagnol. Ces médecins se nourrissaient avec la nourriture des SS et nous refilaient leur soupe. Cela m’a permis de passer ce cap.
Au bout de deux ou trois mois, ce travail s’est arrêté, je ne sais pas pourquoi, mais le Kommando en tant que tel n’a pas été dissous, nous avons continué à habiter le Revier. Je dois dire que nous avions pratiquement un statut d’infirmier et nous logions dans le dernier petit Block avec les médecins, où la vie était quand même plus facile. J’ai été affecté aux services généraux du camp, c’est-à-dire que je portais, par exemple, les vêtements à la désinfection, je portais les tinettes, je reconnais que ce travail à ce moment-là était moins pénible que tous les autres que j’ai faits après. Je suis resté jusqu’au mois d’août 1944.
Je peux vous citer des faits que j’ai vus. En octobre 1943, j’ai vu des gens faire la queue devant le Block 4 : dix ou quinze hommes faisaient la queue, ensuite j’ai vu les cadavres sortir.
J’ai croisé une ou deux fois le sous-officier SS qui venait piquer les gens ; aujourd’hui, je revois encore la démarche de ce sous-officier SS et je revois ses yeux.
Un autre fait dont je peux témoigner. Un jour, on a dit dans le camp : « ceux qui sont les plus bancals, on va les retaper, on va les envoyer au sanatorium » . Pour nous, c’était un mot magique… Ici, vous êtes dans le seul camp de catégorie III, pour des individus « irrécupérables ». On a choisi en effet les plus « bancals », et sont arrivés des cars avec les vitres teintées : les gars sont partis contents et ça a recommencé quinze jours après.
Je ne peux pas dire le nombre exact à chaque fois, quarante, soixante ou quatre-vingts, je n’ai pas de notes précises, je n’ai pas les dates. On ne pouvait pas écrire. Mais ce qu’on sait et que l’on a su très vite au camp, c’est que tous ces hommes qui avaient été mis dans les cars avaient été portés comme décédés le jour même du départ dans les registres du camp. On a su à partir de ce moment-là que le sanatorium était la mort assurée. Ça a continué et à partir de ce moment-là, les gars savaient qu’ils allaient à la mort.
Un matin, nous étions à l’appel devant le Block 4. On a vu passer une quarantaine de bonshommes qui revenaient du Block 8, c’était vraiment atroce : les gars se traînaient avec des bandages de papier, les excréments qui coulaient et en passant devant moi – j’étais au premier rang avec mon camarade de Grenoble, à l’appel – en reconnaissant mon triangle F, il a vu que j’étais français et ce Français en passant devant moi, m’a regardé et a dit : « faites donc quelque chose »… Qu’est-ce que vous pouvez faire ? vous n’avez pas le droit de bouger, vous savez qu’ils vont mourir, eux savent qu’ils vont mourir, vous pouvez regarder le ciel si vous y croyez, vous ne pouvez rien faire, vous pouvez prier si vous croyez, vous ne pouvez pas les regarder en face parce que c’est trop dur, c’était ça notre vie… entre nous, ces jours-là, on avait un dicton : « aujourd’hui l’air est épais » et quand l’air était épais, on avait de la difficulté à respirer, croyez-moi…
Voilà mon témoignage de mon séjour ici, Je suis resté ici jusqu’en août 1944.
Après je suis allé dans d’autres Kommandos.
Jaroslaw KRUZYNSKI, matricule 26 297 (Mauthausen, Melk, Ebensee)
↑ haut de page ↑
Le secrétariat
Pierre SAINT MACARY et Juan DE DIEGO
Pierre SAINT MACARY :
Nous sommes ici dans la pièce où était la « Schreibstube » c’est-à-dire le secrétariat central du camp, où les bureaucrates (détenus) géraient les effectifs.
Il y avait trois postes de secrétaire, sensiblement devant chaque fenêtre.
Le premier était un déporté tchèque, Dany, qui gérait la totalité des effectifs, c’est-à-dire jusqu’à cinquante mille personnes présentes, et, au cours des années, il a géré cent cinquante mille personnes environ avec des mouvements d’entrée et de sortie. Il savait quels effectifs il y avait au camp central, à Melk, à Ebensee, tant de morts, tant de vivants.
Le deuxième, Hans Maršálek, devenu par la suite l’historien du camp, gérait le travail puisque les SS vendaient la main d’œuvre à des entreprises, surtout dans la deuxième partie de la guerre. Il affectait les individus selon les demandes des entreprises, par exemple à Gusen, deux cent cinquante hommes tous les matins pour Messerschmitt… C’était lui le marchand d’esclaves… Le troisième était Diego, ici présent, il accomplissait les tâches complémentaires, la principale étant de tenir l’état civil du camp. Or il n’y avait ni naissance, ni mariage, seulement des décès, c’était d’une certaine façon « l’homme des morts ».
Juan DE DIEGO :
Il y a beaucoup de femmes dans ce groupe et je veux rendre hommage aux femmes parce qu’il y a eu beaucoup de femmes déportées et à Mauthausen aussi. Je peux vous dire que c’est l’honneur des femmes d’avoir fait grève pour ne pas aller travailler ; à Amstetten, les femmes ont eu plus de courage que les hommes.
Pierre SAINT MACARY :
En fait, il y a eu peu de femmes à Mauthausen, de l’ordre de trois mille, arrivées dans les derniers mois de la guerre. Elles sont parties de Ravensbrück en mars et sont arrivées dix jours plus tard. Elles ont été précipitées dans le tourbillon de la fin de la guerre et en particulier, on les a envoyées effectuer des tâches spécialement pénibles et meurtrières : elles ont été appelées à déblayer les gares de Wels et d’Amstetten qui avaient été bombardées. Il y eut des tuées et des blessées par les bombardements. C’étaient pratiquement toutes des femmes « NN ».
Juan DE DIEGO :
Les femmes ont fait grève un jour, puis la situation a évolué, il n’y a plus eu de travail… je vous le dis franchement, les hommes n’ont pas été capables de le faire.
On oublie aussi les enfants : il y a eu des enfants à Mauthausen, ils ont eu des sorts très divers, certains protégés, d’autres martyrisés.
Des Espagnols, on dit : « oui les Espagnols, ils étaient bien placés »… oui, pourquoi ? parce que nous les Espagnols, quand nous sommes arrivés en 1940, les prisonniers qui étaient ici avant nous étaient tous des « droit commun », ils n’avaient pas de métier ; il n’y avait pas de maçons ni de menuisiers, aucun des métiers qui puissent construire le camp. Nous qui venions d’Espagne, nous étions des travailleurs, des professionnels de tout le corps social ; tous ces murs ont été construits par les Espagnols, ils savaient travailler… Être maçon, menuisier et tous les métiers du bâtiment. Être cuisinier à Mauthausen, c’était être un comte, un marquis ou quelque chose comme ça, mais avoir simplement un métier c’était la vie… Sinon on allait à la carrière, traîner des pierres, travailler au marteau-piqueur, tailler des pavés. Ils s’empoisonnaient avec la poussière de granit ; épuisés, ils mouraient sur place, parfois on les tuait sur place. La mort était partout, du haut d’un mirador ou à coups de « gummi »… Ici même, on pendait les types avec les bras retournés.
Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner : quand on voit les morts, on s’habitue ou on se suicide… et moi, il a fallu que je m’habitue à voir les morts, et les morts, quand on les regarde, ils ont tous une expression… soit dans les mains, soit dans la bouche, soit dans les yeux…, chaque mort dit quelque chose et chaque jour, quand j’identifiais les morts de la journée, je cherchais à lire dans leur visage qui ils avaient pu être… [il ne peut finir sa phrase].
Pierre SAINT MACARY :
Une fois de plus, l’émotion de Diego nous coupe le souffle.
Les secrétaires faisaient ce qu’il leur semblait bon en fonction des ordres des SS. Ils décidaient que les Français qui sont arrivés en avril 1944 comme moi, iraient créer le Kommando de Melk. Il y avait ici un pouvoir strictement bureaucratique, ici on gérait des fiches, des Häftlinge, les numéros. Tant qu’ils ne mettaient pas en cause les ordres des SS, ils avaient une relative liberté de choix. Finalement, c’était à cet endroit que se décidait, pas de façon individuelle ni précise mais en masse, le sort des gens par l’affectation qu’on leur donnait…
Cela a été aussi un des lieux où s’est exprimé le pouvoir clandestin. Il y a eu des grands développements sur ce pouvoir clandestin, savoir s’il était tout puissant, de quelle couleur il était, ce qu’il faisait, ceux qu’il condamnait, ou ne condamnait pas ; en réalité, ici au moins, c’est un pouvoir qui s’est créé très lentement. Un pouvoir clandestin se crée par des solidarités entre les gens et en général avec des solidarités préétablies, c’est-à-dire que si vous avez été dans le même mouvement de Résistance, si vous avez été dans le même parti politique, si vous êtes de la même nationalité, vous avez des contacts entre vous, c’est la multiplicité de ces contacts qui, petit à petit, fait un appareil clandestin.
Maintenant, bien plus tard, il est possible de parler de cet appareil clandestin comme d’un système élaboré : en vérité, c’était quelque chose d’infiniment dangereux, totalement clandestin évidemment, et qui avait des effets « gauches », c’est-à-dire, jamais assurés : on pouvait espérer que telles personnes seraient orientées de telle façon, on pouvait espérer que les maçons travailleraient comme maçons, les menuisiers comme menuisiers, les mineurs comme mineurs et puis il fallait bien des manœuvres, les intellectuels étaient manœuvres, ils n’avaient pas de métiers transférables. Jorge Semprun a dit qu’il y avait trois façons de se sortir d’un camp de concentration : la première c’est de parler l’allemand, la deuxième c’est d’avoir un métier utilisable, la troisième est d’avoir de la chance.
Lieu de pouvoir SS, lieu de pouvoir bureaucratique, lieu de pouvoir clandestin qui a fait ce qu’il a pu. Ce qui est sûr, c’est qu’un tel pouvoir a existé mais on est pratiquement incapable d’établir ses effets précis.
Juan DE DIEGO :
Ainsi donc, quand un nouveau arrivait au camp, on lui disait de dire qu’il était menuisier, ou maçon, pour mieux les utiliser et si possible les « planquer » !
Il y eut d’autres formes de la solidarité, par exemple, à une certaine époque, il y a eu des commissions médicales qui venaient à Mauthausen et ces commissions médicales déterminaient les inaptes au travail, en fait les condamnaient à mort, et on sélectionnait les gens : tantôt à droite, tantôt à gauche. C’étaient des médecins venus de l’extérieur qui faisaient cela, des commissions spéciales ; mais nous, nous savions quand venait une de ces commissions, et l’on prévenait nos camarades de sortir du camp ce jour-là parce que ceux qui restaient dans le camp risquaient la mort ; même malades. Il y a eu la solidarité à l’infirmerie, il y a eu des gens condamnés à mort qu’il fallait sauver. Avec la complicité des médecins déportés qui travaillaient à l’infirmerie, quand il y avait un mort, on donnait le nom du mort à un détenu condamné par les SS, comme ça on sauvait des vies…
Pierre SAINT MACARY :
Les cas de substitution de gens condamnés (cf. le livre de Stéphane Hessel [Danse avec le siècle, Éditions du Seuil, Paris, 2007]) se comptent sur les doigts des deux mains au maximum.
Au camp, on subissait mais il y a eu des hommes qui ont essayé comme ils ont pu, de mettre la fatalité en échec… de faire reculer l’absurde…
Juan DE DIEGO :
Croyez que ma grande école a été le camp. Quand on demande de quel diplôme je suis titulaire, je dis quelquefois « de l’Université de MAUTHAUSEN ».
Juan DE DIEGO, matricule 3 156 (Mauthausen)
Général Pierre SAINT MACARY, matricule 63 125 (Mauthausen, Melk, Ebensee)
↑ haut de page ↑
Les femmes à Mauthausen
Marie-José CHOMBART DE LAUWE
Je vais vous parler des femmes de Mauthausen.
Le convoi qui est arrivé ici le 7 mars 1945 venait de Ravensbrück.
Nous étions quelque mille huit cents femmes ; dans ce convoi, il y avait les femmes « NN » de Ravensbrück et des Tziganes avec pas mal d’enfants. L’une d’entre elles a même accouché dans le train. Nous sommes les seules femmes à avoir vécu, si l’on peut appeler ça vivre, à Mauthausen. Il y eut des passages de femmes avant nous, mais elles ont disparu.
Le 2 mars à Ravensbrück, nous sommes entassées dans un train : on mettra cinq jours à arriver ici. Nous avions reçu du pain pour trois jours ; le voyage a duré cinq jours ; ce sont donc des femmes épuisées qui descendent des wagons à la gare de Mauthausen – où vous êtes passés ce matin – dans la nuit, qui traversent le village et qui montent vers le camp. Celles qui ne pouvaient plus avancer étaient abattues d’une balle dans la tête. Nous serpentions le long de ce petit chemin avec l’horrible tentation de nous laisser tomber pour en finir.
Nous sommes arrivées dans le camp. Nous sommes passées à la douche en nous demandant bien ce qui allait nous arriver puisque nous devions disparaître… On a été sauvées parce que ce voyage a duré quelques jours et qu’entre temps, une lettre était parvenue à Bernadotte, comme quoi ce convoi était en grand danger et Bernadotte (responsable de la Croix-Rouge) a négocié notre survie avec Himmler. On a été « recueillies », si l’on peut dire, par des Kapos hommes, il n’y avait pas de femmes. On a été épouillées, nous nous sommes trouvées face à des camarades de déportation, des déportés hommes, c’était de jeunes prisonniers russes très corrects avec nous. Nous avons été emmenées dans les Blocks 16, 17 et 18, Blocks de quarantaine. Moi, j’étais au 17 ; au 16, il y avait les plus malades et les blessées.
Il y avait aussi un « puff », c’est-à-dire un petit bordel (pas le grand bordel pour les SS) qui servait aux Kapos.
Nous, les déportées résistantes ou politiques, nous n’avons jamais subi de violences sexuelles… mais c’était humiliant…
Il y a eu l’angoisse d’une première sélection qui a envoyé des femmes sur Bergen Belsen, dont la plupart ne sont pas revenues.
Quelques jours après, c’était le 20 février, on est parties au travail à Amstetten, à la grande gare de triage bombardée par les « forteresses volantes » américaines. Nous partions à deux heures du matin, en train, on arrivait sur ce terrain où il fallait porter des poutres très lourdes, tirer les rails, c’était épuisant… encadrées par de très jeunes SS de seize à dix-sept ans, des petites brutes, des sauvages, endoctrinés par la Hitlerjungend ; j’ai vu ces jeunes jeter des pierres à des femmes pour les faire travailler plus vite, des femmes qui auraient pu être leur grand-mère…
Là, s’est passé un premier drame : un bombardement aérien par les « forteresses » américaines. Nous avons eu des camarades tuées et gravement blessées qu’il a fallu remonter.
En principe, cette équipe devait rentrer à minuit, l’équipe de relève du jour suivant devait partir à deux heures du matin. A minuit, personne… elles ne rentrent pas… nous avons appris qu’elles avaient été bombardées… Là-dessus, nous nous sommes révoltées… nous avons dit qu’on ne partirait pas, ça a demandé une certaine audace évidemment… le Commandant est arrivé, revolver à la main : « si vous ne partez pas, j’en abats dix tout de suite »… Malgré cet acte de résistance, nous avons bien été obligées de partir, nous sommes parties… nos camarades étaient blessées… les SS eux-mêmes avaient très peur… nous sommes rentrées épuisées…
Au deuxième relais, les SS ont décidé de ne plus nous envoyer, je pense pour deux raisons : notre travail était inefficace (nous étions épuisées et c’était trop lourd pour nous) et les civils autrichiens commençaient à nous apporter quelque linge et cela faisait très mauvais effet…
Nous sommes donc restées dans le Block de la Quarantaine jusqu’au début avril… où nous sommes descendues par cet escalier, les femmes marchaient difficilement et quelques-unes avaient des fractures du bassin, des jambes, elles ont été descendues par des « Stubel », des espèces de cuves à pain, deux manches d’un côté, deux manches de l’autre, ils avaient réquisitionné des hommes pour porter ces femmes… ces cuves étaient trop petites, les bras et les jambes dépassaient… imaginez cette descente… je ne vous donne pas trop de détails… c’était atroce…
Nous sommes arrivées dans un champ, un espèce de désert de pierres, apocalyptique, on nous a emmenées dans une espèce de grange dans laquelle on a entassé les trois Blocks, avec les trois chefs de Blocks… parmi ces chefs de Blocks, il y avait une tenancière de maison close, une Allemande, véritable brute et ces trois chefs de blocks étaient en compétition, c’était la foire d’empoigne… dans cette baraque, il n’y avait pas de lit, quelques bottes de paille qui ont entraîné des disputes…
J’évoquerai le souvenir d’une petite Belge que nous appelions « Miette », emmenée au Revier, avec la cavité de la hanche effondrée ; nos camarades hommes lui avaient mis une broche en fer dans le talon, on avait installé une planche en pente, on lui avait mis une ficelle et une pierre au bout, on avait mis sa jambe en extension… voilà la situation de ces femmes…
À l’extérieur, il y avait un minuscule ruisseau où nous allions puiser de l’eau… On nous a mis trois tinettes assez hautes, une femme tzigane battait celles qui n’arrivaient pas à se mettre dessus…
Sentant la fin venir, les SS en uniforme ont disparu… à la fin l’encadrement était féminin.
Après notre convoi, quelques femmes sont arrivées à Mauthausen. J’ai quelques témoignages.
Par exemple, nous avons vu arriver des femmes polonaises et russes venant de Varsovie ; je me souviens d’un cas atroce : une jeune Polonaise qui avait tenté de s’échapper du convoi, avait été tirée aux jambes par les gardiens et ses jambes suppuraient avec des trous énormes… après des jours et des jours dans le train, elle est morte ici…
J’ai vu aussi un groupe de Hongroises juives et un convoi d’Italiennes et de Yougoslaves qui venaient d’une usine d’armement…
Ce que je vous dis, c’est ce que j’ai vu, j’ai écrit ces dates dès mon retour…
Ces dernières semaines ont été l’équivalent d’un camp d’extermination…
Nous allions mourir là quand, le 22 avril, est arrivée une surveillante me disant : « Faites sortir toutes celles qui peuvent encore marcher ». On a eu très peur, on s’est dit que c’était encore une sélection, on est sorti, il y avait effectivement des hommes avec le brassard « Croix-Rouge Internationale ». La première réaction a été la joie, mais tout de suite après on s’est aperçues que c’était une mise en scène… ils ont tiré… alors les femmes sont remontées, les blessées ont été emmenées au Revier en dur, dans le centre du camp ; nous sommes restées toute la nuit et finalement ces énormes portes se sont ouvertes, les camions blancs sont arrivés et la Croix-Rouge a obligé les SS à nous donner leur pain… on a roulé jusqu’à la Suisse durant trois jours… on est resté devant la frontière sans pouvoir passer…
Marie-José CHOMBART DE LAUWE, matricule 2 807 (Ravensbrück, Mauthausen)
↑ haut de page ↑
TÉMOIGNAGES SUR LES KOMMANDOS
En dehors des témoignages sur le camp central, il existe également un certain nombre de témoignages sur les Kommandos. En voici, à titre d’exemple, quelques-uns.
• Jean LAFFITTE et Maurice DELFIEU : Ebensee
• Ernest VINUREL : Gunskirchen
• Pierre Serge CHOUMOFF : Gusen
• Robert ZARB, Simon LAUVERGNAT et Yves DROMARD : Loibl Pass
• Ernest VINUREL, Raymond HALLERY et René GILLE : Melk
• José BORRÁS : Steyr
Ebensee
Jean LAFFITTE et Maurice DELFIEU
Jean LAFFITTE :
Imaginez une montagne dont on aurait rogné le pied. Un mur de rochers haut de deux cents mètres et long de cinq cents. À la base des trous qui, de loin en loin, sont creusés dans ce mur : sept tunnels qui s’enfoncent dans la pierre blanche. Au-devant du mur, un immense espace qui s’agrandit chaque jour un peu plus. Là-dessus, des voies ferrées, des trains de wagonnets, des automotrices, des locomotrices, des baraques, des transformateurs, des tuyaux, des câbles électriques, des projecteurs. Au milieu des amas de ferraille et de matériaux de toutes sortes, des hommes qui se déplacent, ployés sous le fardeau : dix hommes pour porter un rail, huit hommes pour porter un poteau. La ronde ne s’arrête jamais.
D’autres hommes creusent des tranchées, déchargent les wagons qui entrent par trains complets sur le chantier ou s’emploient à l’un des mille travaux qui donnent à cet espace cyclopéen l’aspect d’une fourmilière géante.
Cela n’est rien. Rentrons dans un tunnel. La voûte fait huit à dix mètres de haut. L’eau suinte sur les rochers faiblement éclairés. Sur le sol, on trébuche sur les rails, on marche dans l’eau et dans la boue. Un bourdonnement sourd grandit au fur et à mesure qu’on avance. Les wagonnets vont et viennent sans arrêt. Arrivés à l’endroit du travail, on ne voit plus rien qu’un nuage phosphorescent que la lumière des projecteurs n’arrive pas à percer et que les aspirateurs sont impuissants à absorber. On se trouve, sans l’avoir vu, au pied d’une énorme perforatrice qui ressemble à une pièce d’artillerie. Vingt hommes travaillent là à percer la montagne dans la poussière, dans le courant d’air, au milieu d’un vacarme assourdissant. Placés sur des échafaudages, le marteau-piqueur à la main, ils creusent des trous dans le roc. Ils sont entièrement recouverts d’une poudre blanche qui les fait ressembler à des spectres. On ne voit plus leurs yeux. On dirait des statues de pierre, convulsées par la trépidation des machines.
Quand les trous ont une profondeur de deux mètres, on les bourre de dynamite. Les hommes sortent du tunnel pour quelques minutes. Une explosion sourde ébranle la montagne, et l’on recommence à percer pendant que l’autre moitié de l’équipe déblaie à la hâte l’éboulement qui vient de se produire.
C’est en voyant ces hommes, c’est en voyant le Steinbruch pour la première fois, que j’ai compris comment les esclaves de l’Antiquité ont pu, au temps jadis, construire les pyramides d’Égypte.
Maurice DELFIEU :
Le chemin était effroyable
Il y avait dehors un mètre vingt-cinq de neige et le régime du Schonungsblock ne nous avait pas aguerris ! On voyait passer dans les allées voisines, sous les pins écrasés par la neige, la triste théorie des travailleurs qui, après d’interminables stations sur la place d’appel, montaient vers les tunnels, les vêtements traversés par la neige fondue, la plupart du temps sans coiffure, les pieds chaussés de galoches informes.
Dans l’appréhension que nous causait la perspective du travail hors du camp, quel que fût le Kommando auquel nous étions affectés, les difficultés du chemin d’accès tenaient une large part. On peut dire que nous arrivions au chantier déjà fourbus par la marche et que la course du retour, succédant à une journée de travail rarement exempte de douloureuses péripéties, nous assénait le coup de grâce.
Il n’y avait que deux kilomètres et demi entre le camp et le Steinbruch (la carrière) ; mais le chemin en était effroyable : il était tracé au flanc de la montagne et comportait, dans sa première moitié, une montée rapide qu’il fallait gravir au pas de course, à perdre haleine, en conservant son rang et sans se laisser distancer par les Kommandos suivants, sous peine de recevoir des coups des SS escorteurs, placées en serre-file, des coups de pied ou des coups dans les reins.
Puis brusquement venait la descente, sorte de course au clocher, glissade vertigineuse, plus dangereuse que la montée.
Nous voilà au chantier ! À nous la pelle, la pioche, la brouette, les sacs de ciment, la perforeuse qui nous ébranle la carcasse, le marteau de trente livres, les insultes et les coups !
Il y avait des gazons bien entretenus, des fleurs
Dans tous les camps de concentration et d’extermination, il y avait des gazons bien entretenus, des fleurs, des balustrades rustiques assez élégantes, des allées ratissées, couvertes de gravier fin, de baraques peintes en vert contre les parois desquelles grimpaient des pois de senteur. Les Blocks étaient décorés intérieurement de petits vases où poussaient des sapins minuscules et des géraniums… ; mais on vous matraquait devant ces tendres évocations de la nature et, le soir de Noël, alors les chefs de Blocks avaient rivalisé d’ingéniosité pour décorer leur baraque, j’ai vu un pauvre bougre noyé dans le lavabo, juste au pied de l’arbre de Noël, orné d’étoiles, de noix dorées et de flocon de verre filé ! Hypocrisie.
Jean LAFFITTE, matricule 25 519 (Mauthausen, Ebensee) – in Ceux qui vivent, Éditions Hier et Aujourd’hui, 1947 ; réédité : Livre club Diderot, 1970
Maurice DELFIEU, matricule 62 253 (Mauthausen, Ebensee) – in Récits d’un revenant, Mauthausen-Ebensee 1944-1945, Publications de l’Indicateur universel des PTT, 1946 et 1947, p. 129 et 220
↑ haut de page ↑
Gunskirchen
Ernest VINUREL
Le camp de Gunskirchen n’en était pas un à proprement parler. Dans la liste des camps annexes de Mauthausen, il figurait dans la rubrique « Durchgangslager », « camp de transit ». On a fait entrer notre colonne, ou ce qu’il en restait, dans une construction entre la baraque et le hangar, posée à même le sol. Ce local était déjà bondé, mais la cohorte affluait toujours, et l’on s’entassait. Bientôt on fut tellement serré qu’on ne pouvait plus se tenir que debout. On étouffait. Dans les autres hangars, la situation devait être la même. Les femmes et les enfants, on les avait dirigés vers un autre hangar, à part. Cet abri avait dû être posé juste avant notre arrivée, car l’herbe poussait à l’intérieur, parsemée de fleurs des champs. L’herbe et les fleurs ont vite disparu. Le sol était maintenant une étendue de boue, détrempée, gorgée des pluies tombées les jours précédents. C’était une structure de hangar mais rien d’autre : aucune installation, pas un banc, pas une paillasse. Devant chacune des deux portes, se tenaient deux jeunes SS, revêtus d’imperméables, les armes pointées sur nous. Quand toute la colonne – ce qu’il en restait – a été entassée à l’intérieur, les deux SS ont disparu. De ce moment, je n’ai plus vu de soldats allemands jusqu’à l’après-midi de la libération. Cependant ils étaient là, tout autour du camp, mais restaient invisibles. On savait leur présence aux coups de feu qui se déclenchaient dès que quelqu’un, même un enfant égaré, s’approchait des abords du camp dont les limites n’étaient pas très précises. Une fois, j’ai aperçu, passant à toute allure l’Unterscharführer (sergent) Hagen, qui commandait – en réalité il ne commandait pas grand-chose : il n’y avait pas d’appel, pas de corvée à faire exécuter. On ne bougeait pas du hangar, chacun allongé sur sa couverture, où l’on agonisait lentement, chacun à son rythme. Si, la première nuit, il fallut dormir debout, faute de place pour s’allonger ou même s’asseoir, l’espace dont on disposait s’est agrandi rapidement à mesure que, de cette masse de gens, beaucoup mouraient. Ils mouraient debout. On sortait sans cesse des cadavres, on les posait le long du hangar, et cela nous permettait de bouger un peu, de gagner un peu d’espace pour les vivants. Ensuite, on n’eut même pas la force de les sortir ; les morts restaient sur place.
On ne se parlait plus. On était arrivé à un tel degré d’épuisement, d’apathie, qu’on ne se rendait même pas compte de ce qui se passait alentour. Le sol était vraiment jonché de morts et de moribonds. Les seuls événements qui rompaient le silence étaient les râles des agonisants. De temps en temps, quelqu’un qui avait encore ce courage et cette force se levait et sortait se soulager dans la fosse creusée à côté. Le soir tombé, on s’allongeait sur les corps, dont certains bougeaient encore.
Ernest VINUREL, matricule 71 329 (Gunskirschen, Mauthausen, Melk) – in Rive de cendre, Éditions L’Harmattan, coll. Mémoires du XXe siècle, 2003
↑ haut de page ↑
Gusen
Pierre Serge CHOUMOFF
L’an mil neuf cent quarante-cinq, le 4 août à 10 h 30 a comparu devant Mademoiselle CHALUFOUR chargée de mission au Service de Recherche des Crimes de guerre ennemis, 50 avenue de Wagram à PARIS :
Monsieur Pierre CHOUMOFF
Profession : agent technique
date de naissance : 2 juin 1921
demeurant 7 boulevard Brune
a déposé les faits suivants :
J’ai été arrêté pour activité politique le 11 mars 1942 par la Brigade Spéciale ; séjour de 1 mois au dépôt. Transmis à la Gestapo, prison du Cherche-Midi jusqu’au 24 août 1942 puis comme otage à ROMAINVILLE jusqu’au 1er mars 1943, déporté à cette date au camp de MAUTHAUSEN et le 28 avril au Kommando de ce dernier, camp de GUSEN.
Considéré comme Kommando disciplinaire du camp de MAUTHAUSEN, le camp de GUSEN n’a jusqu’à présent que très peu retenu l’attention publique. C’est pourtant un camp jouissant d’une grande autonomie pourvu jusqu’en 1944 d’une numération propre, d’archives politiques de four crématoire, etc. dont l’importance ne fit que croître, nécessitant sa subdivision en 3 camps d’un contingent total de 26.000 détenus. Le camp de GUSEN II créé en été 1944, fruit de l’expérience de tant de créations et d’exploitations de camps de concentration, a été certainement dans la période 1944/1945 le plus terrible de tous. Le commandant de GUSEN n’était-il pas le Hauptsturmführer SEIDLER, l’ancien commandant d’AUSCHWITZ ?
1° SITUATION DU CAMP :
À l’encontre de MAUTHAUSEN, situé sur une hauteur et dominant la vallée du Danube, GUSEN se trouve sur la plaine même du Danube au pied de ces élévations utilisées et exploitées soit comme carrières de pierre, soit comme réceptacles d’immenses galeries souterraines devant abriter des usines de guerre et borde sur une grande longueur la route au nord du Danube de MAUTHAUSEN à LINZ (à 6 km de MAUTHAUSEN, et à 21 km de LINZ). Les murs extérieurs d’enceinte beaucoup moins hauts que ceux de MAUTHAUSEN mais construits sur le même type n’en assuraient pas moins une « étanchéité totale », flanqués de « miradors » à la silhouette traditionnelle.
Un aperçu complet ayant été donné tant sur le climat que sur la région dans le compte-rendu de MAUTHAUSEN, il est par conséquent inutile d’y revenir.
2° DESCRIPTION ACTUELLE DU CAMP DE GUSEN I :
Le camp se compose de 36 Blocks habitables disposés d’une façon régulière sur 5 rangées de 8 [sic *], lavabos et lieux d’aisance situés à part chaque deuxième rangée. La porte monumentale du camp donne sur l’AppellPlatz, vaste place pouvant contenir alignés les 13 000 détenus effectifs du camp, limitée successivement par le mur d’enceinte, la cuisine, la 1ère rangée des Blocks et le bordel.
La double enceinte constituée de fils de fer barbelés électrifiés et d’un mur de pierre à l’extérieur assurant dans le milieu un chemin de ronde. Four crématoire et douche situés à l’intérieur du camp entre la 4ème et la 5ème rangée de Blocks. À côté du four crématoire, sur le terre-plein de gazon qui borde les barbelés sur tout le pourtour, se dresse le mur de maçonnerie servant aux fusillades. Comme dans chaque camp, des Blocks sont réservés soit au Revier (« hôpital »), soit aux « invalides », soit à la quarantaine et se trouvent, dans ce dernier cas, isolés du reste du camp par une enceinte de barbelés et, même, pour le Block 16, d’un mur empêchant tout contact entre l’intérieur et l’extérieur. Du camp même, on distingue les détenus travaillant à différents niveaux dans les carrières, recouvertes de champs, de forêts, on voit nettement la deuxième enceinte de barbelés, dite « grande chaîne de sécurité », flanquée de sentinelles pendant le jour ; sur toutes ces hauteurs se trouvent érigées de grandes baraques analogues à celles du camp, mais en réalité formant de véritables usines de guerre, succursales de Messerschmitt (siège à REGENSBURG) et de Steyr-Daimler-Puch (siège à STEYR), carabines – mitraillettes, puis le grand moulin, casseur de pierre, entouré d’un nuage continuel de poussière de pierre et, enfin, l’immense construction semi-circulaire servant à abriter les nombreuses locomotives, car l’exploitation tant des carrières que des usines de guerre nécessitera la création d’une ligne de chemin de fer se rattachant à MAUTHAUSEN d’une part et à ST. GEORGEN d’autre part sur la ligne de LINZ à VIENNE, sans oublier l’immense réseau de rails à voie étroite pour les wagonnets Decauville. La porte d’entrée servait d’abri à la Kommandantur et aux cachots. De nombreuses constructions destinées aux SS s’étendent sur tout le pourtour.
3° HISTORIQUE :
GUSEN fut créé vers 1938, se composait à l’origine d’un ou deux Blocks et servait de lieu pénitentiaire pour MAUTHAUSEN. Il n’y avait donc que la Strafkompanie [unité punitive], composée à cette époque d’Autrichiens et d’Allemands, criminels professionnels politiques, asociaux, homosexuels. Les carrières n’étaient qu’un prétexte à leur extermination, mais les conditions de vie et de travail dont les SS pouvaient tirer parti pour leur bénéfice personnel firent hâter son développement.
1939 et 1940 virent avec les premiers arrivages massifs de Polonais la mise en marche d’une exploitation régulière des carrières et la construction du camp, c’est-à-dire : l’assèchement du terrain, le dallage de l’AppellPlatz, l’édification de différents Blocks de prisonniers et de SS, tout ce travail effectué par les prisonniers seuls, tour à tour extrayant les pierres, les taillant, les portant. Le compte-rendu de MAUTHAUSEN a suffisamment montré les conditions d’exploitation des carrières sous l’appellation de D.E.S.T. (Deutsche Erd Und Steinwerke) pour qu’il nous soit inutile d’y insister ici. Rappelons simplement que la discipline et l’extermination étaient maintenues et réalisées par ces pires éléments punis et expulsés de MAUTHAUSEN.
En 1941 arrivèrent les Espagnols : sur les 7 000, il en restait environ 400 à la libération. L’effectif normal du camp était à cette époque de 6 000, la numération allait jusqu’à 15 000 et recommençait, les nouveaux venus prenant les numéros des morts.
À notre connaissance, ce cycle eut lieu 4 fois avant le rattachement et la numération à MAUTHAUSEN.
Achèvement de la construction du camp. Mise en service du casseur de pierre appelé Schottersih* comprenant 3 moteurs de 200 cv. Le travail était très malsain à cause de l’atmosphère complètement viciée, il était réservé à des compagnies de représailles.
C’est l’époque des 3 appels quotidiens par n’importe quel temps, des exercices en masse sur l’AppellPlatz, il n’y a encore que peu de lits, le coucher en « sardine » est une torture pour chaque nuit, contrôle de propreté et vermine continuel, fouilles méthodiques, les lavabos étant situés à l’extérieur des Blocks, obligation pour les détenus de s’y rendre en chemise seulement, etc. tout n’est prétexte qu’à la brutalité, à la tuerie tant des SS que de leurs seidz [aides*].
Lever avant le jour pour attendre l’apparition du soleil sur l’AppellPlatz, marché d’esclaves pour trier les détenus en vue de les incorporer dans différentes équipes de travail, chasse à l’homme pour ceux qui sont conscients, imposition du nombre donné de morts par Block, par équipe de travail : c’est le règne de l’Hauptsturmführer CHMIELEWSKY, aidé de l’Arbeitsdienstführer KLUGE, du Rapportführer DAMASKO.
Les quelques centaines de juifs arrivés à GUSEN à cette époque sont immédiatement exterminés. C’est le tri, la sélection des invalides choisis par le commandant lui-même, c’est le régime des douches froides seules existantes, de l’habillement élémentaire (une chemise un veston), de la nourriture de famine, de ce jour, nuit et jour durant au garde à vous sur l’AppellPlatz par 50 cm de neige après de soi-disant évasions, c’est le contrôle rigoureux des morts que l’on a forcé de présenter au cours des appels.
1942 n’est que la suite mais voit l’arrivée des premiers convois de Russes, prisonniers de guerre et civils requis avec cette « désinfection » machiavélique qui deviendra un des moyens les plus sûrs d’extermination. Sélection continuelle d’invalides, utilisation de l’auto-fantôme, de l’auto-chambre à gaz, prenant ces victimes à GUSEN pour le four de MAUTHAUSEN et vice-versa, c’est la destruction par l’eau froide et les coups aux douches, l’abattage régulier de deux charrettes de morts à la carrière chaque jour. Ce sont les piqûres au Revier, les fusillades de Polonais et de Russes, de Polonais condamnés depuis 2 ans et qu’on laisse dans l’incertitude jusqu’au dernier moment, c’est le cachot avec sa « question » pour tous ceux qui enfreignent les règlements, qui déplaisent aux bourreaux, ce sont les chiens talonnant à chaque instant des êtres demi-morts.
En été, premier convoi des Belges, 300 dont aucun ne devait survivre ; en novembre, de nouveau quelques Belges et des Français venant du nord de la France dont seules quelques unités se retrouvent. L’équipe se relaye : c’est maintenant l’Hauptsturmführer SEIDLER secondé de BECK et, surtout, par le Rapportführer KILLERMAN. SEIDLER comme commandant de GUSEN était sous les ordres directs de TINIS, commandant de l’ensemble des camps dans la région de MAUTHAUSEN et de BECHMAYER, commandant du camp même de MAUTHAUSEN.
1943 marque un tournant dans la politique nazie à l’égard des déportés. En effet, l’ampleur que prennent les bombardements, la gravité des dégâts causés conduisent à utiliser ces hommes qui jusqu’à présent n’étaient bons qu’à mourir comme ouvriers d’usines de guerre ; le repliement d’armes s’effectue, le matériel plus ou moins avarié resservira dans ces baraques situées en milieu de camp de prisonniers et, par cela-même, la crainte de futurs bombardements ne sera-t-elle pas éloignée.
Ainsi, en 1943-1944, petit à petit le camp se modifie, l’influence des Rüstung sera prépondérante ; quelquefois un peu rudimentaire, le contact forcé avec des civils employés dans les usines de guerre modifiera un peu la discipline dans ces usines.
Au camp même, on constatera une légère amélioration, mais ce sont toujours les désinfections, les prétextes des évasions pour tenir 3 nuits consécutives les Polonais sur l’AppellPlatz, pour donner pendant 1 mois demi-ration aux Russes, les obliger à des exercices avec bastonnade et noyade pour une cinquantaine d’entre eux par jour et à lyncher devant le camp convoqué en entier ceux des leurs repris. Les pendaisons spectaculaires avec discours cyniques du commandant « Qui n’est pas d’accord n’a qu’à le dire, il aura satisfaction. » Le gazage du Block 16 pour se débarrasser de quelques-uns, les sélections continuelles…
Début 1943 vit arriver 150 Français « NN » venant de ROMAINVILLE et les premiers convois des 1 000 partis de COMPIÈGNE qui illustrèrent ce changement de politique car c’était toujours des convois classés par spécialités.
En janvier 1944, la numération de GUSEN comme celle de tous les Kommandos de MAUTHAUSEN fut rattachée à la numérotation centrale de MAUTHAUSEN (pour GUSEN, de 43 000 à 50 300). Ainsi, les noms de tous ceux qui sont passés avant cette date à GUSEN et y sont morts ne sont indiqués sur aucune archive. Nous ne saurons jamais combien il y en eut, jamais qui ce fut.
L’apport de prisonniers et une nouvelle direction dans les travaux en cours nécessitèrent la création du camp annexe de GUSEN II. Comme autrefois pour GUSEN, ce sont les éléments les plus durs, les plus sauvages que l’on enverra former les cadres de GUSEN II. Le travail principal est maintenant le percement de la montagne, la construction de vastes galeries, de tunnels « Kellerbau » devant servir de vaste hall pour les usines de guerre et devant en même temps abriter les SS et les civils en cas de bombardement. Ce travail se poursuit nuit et jour : à GUSEN même, 5 galeries de 300 mètres de long seront réalisées, quelques-unes abriteront même déjà de nombreuses machines.
Toutes les nationalités sont maintenant représentées, où les nouveaux venus sont décimés comme des mouches.
1945 verra la vaine tentative de poursuite de ces travaux, l’électricité est souvent coupée, l’au manque. Les alertes deviennent une nouvelle possibilité d’extermination en chassant tous dans ces abris, la situation militaire critique renforcera les mesures de répression, les journaux sont absolument défendus, nul ne doit même écouter les informations allemandes de la radio ; seront fusillés tous ceux qui seront surpris à donner des nouvelles, à « organiser » car le contact des civils n’a pu que favoriser les possibilités de trafic de vêtements, d’alcool et d’or. Chaque nuit de 1945 aura eu son tribut de « suicidés » précipités sur les barbelés après la 2ème cloche. Petit à petit, en vue d’empêcher les contacts trop fréquents entre prisonniers et SS, on supprime les Kommandos SS, on les remplace par des femmes allemandes à la cuisine, dans de nombreux bureaux.
Le Bureau du Service Politique – Politisher Abteilung – composé de 4 Polonais et 1 Belge est liquidé. Ils devaient tous être fusillés mais, grâce à l’effondrement sensible de l’armature du camp, ils purent échapper par miracle à leur destin. C’est la rébellion d’une partie de la troupe SS composée surtout d’Ukrainiens voulant soi-disant libérer le camp, tous mis aux arrêts dans le bordel mais gardés très sévèrement en vue d’empêcher toutes communications avec les détenus et les prisonniers. Parmi eux, un certain nombre sera fusillé chaque jour, qu’est-il advenu du reste ? nous ne le savons pas… C’est l’enrôlement dans le Volkssturm de ces criminels allemands auxquels on donnera le même insigne « tête de mort ». Certains partiront à l’armée, d’autres assureront la police à l’intérieur d camp. Ce sont les femmes du bordel promues au rang de SS elles aussi à MAUTHAUSEN.
Nous sommes maintenant dans la dernière période d’extermination rapide de tous les malades, invalides, la préparation hâtive de la sortie unique des abris (l’écoulement des 26 000 détenus prend 1 heure au moins) de manière à faciliter un emprisonnement de tous dans ces galeries dont une était déjà minée. ZIRKIS n’avait-il pas fait le projet d’amener tout MAUTHAUSEN dans ces tunnels ?
Vient ensuite la période de libération. Le front de Vienne est proche, on distingue la nuit l’embrasement du ciel dû à l’artillerie, le commandant ZIRKIS fait construire une série de travaux au-delà de MAUTHAUSEN toujours pas les prisonniers seulement qui font des fortifications appelées « ligne ZIRKIS ». La radio allemande inaugure le Panzegehahr : ce devait être pour les prisonniers le signal de l’emprisonnement dans ces tunnels jusqu’à l’issue du combat qui se serait déroulé avec en première ligne le Volkssturm mobilisé et, dans le cas probable d’un repli des SS, liquidation de ces ouvrages souterrains regorgés de prisonniers en les faisant sauter. Mais la stabilisation momentanée du front de Vienne, l’avance en flèche américaine, la décomposition totale de la dernière période modifient tous ces projets : les SS s’enfuient un jour avant, laissant la garde et la police de VIENNE repliée qui, dès la venue des Américains, se désarme elle-même. Les détenus s’emparent des armes, massacrent leurs anciens chefs de Blocks, s’éparpillent de tous les côtés pour rechercher les SS, piller et assouvir leur vengeance si longtemps contenue.
Lorsque les Américains prirent en charge le camp, l’état sanitaire était absolument déplorable, partout des cadavres menaçaient d’épidémies, une odeur irrespirable. Ils dressent de nombreux panneaux comme dans tant d’autres camps invitant la population à se rendre compte de ce que fut le régime hitlérien. Des patrouilles armées bien organisées, composées surtout d’Espagnols, rattrapèrent quelques SS : SEIDLER lui-même dut se résoudre à se suicider, son corps fut exposé pendant une douzaine de jours à MAUTHAUSEN, « premier cadavre de joie », rançon de combien de centaines de milliers d’hommes.
4° SCHÉMA DE L’ORGANISATION DISCIPLINAIRE :
À l’extérieur du camp, les SS Kommandoführer surveillant la bonne marche du travail et, quelquefois, la répartition de la nourriture, effectuant de nombreuses fouilles à la rentrée au camp des Kommandos extérieurs (la plupart). Qui était pris avec des produits d’origine trop claire, qui avait seulement déplu était mis au cachot, soumis à la pendaison par les mains attachées par derrière pour le faire avouer, recevait de nombreux coups de schlague sur un tabouret propre à ce sévice, avant d’être suicidé dans la majorité des cas.
À l’intérieur du camp, chefs de Block, secrétaires, Kapos formaient une classe non moins redoutable, ayant les mains libres pour exterminer leurs codétenus et vivre à leurs dépens, en leur soutirant leur ration de nourriture, traitant avec les civils soit avec les SS. Possédant tout – or, vêtements, alcool et femmes –, leurs moyens de punition étaient les coups, la pendaison, mais souvent la noyade dans un tonneau dans les lavabos.
5° RÉGIME DE VIE :
- HYGIÈNE : Très peu d’eau pour le lavage, peu de savon ou pas du tout, linge en loques changé tous les mois ou seulement tous les deux ou trois mois, vermine abondante.
- NOURRITURE : Régime normal bien connu dont la description est superflue ; durant une certaine période, les travailleurs de l’industrie de guerre eurent des suppléments fournis par les usines elles-mêmes. Par contre, ½ ration pour les invalides, et ration incontrôlable en quarantaine.
Avant le 28 avril 1945, le camp de GUSEN n’a jamais reçu aucun colis alimentaire de la Croix-Rouge : une tentative fut faite en décembre 1944 par la Croix-Rouge mais SEIDLER lui-même refusa l’aide de cette dernière.
6° RÉGIME DE TRAVAIL :
- 12 heures par jour (nuit et jour) pour les industries de guerre ; la discipline y était quelque peu atténuée, les conditions de travail meilleures parce que abrités des intempéries.
- « Kellerbau » : 3 équipes de 8 heures ; travail pénible dû à l’écrasant labeur du percement des roches et au danger constant que présentent les éboulements.
- Les carrières, où la discipline s’était elle aussi quelque peu adoucie, mais laissaient tous les hommes sans défense devant le soleil de plomb ou la pluie torrentielle.
- Les Kommandos d’entretien du camp et de la troupe SS composés presqu’exclusivement de Polonais et de quelques Allemands, Tchèques, Espagnols formant à l’intérieur du camp une redoutable aristocratie, les criminels « Prominents » et logeant dans les Blocks 1 et 2 réservés pour eux, dont l’accès était rigoureusement interdit aux autres. Les Polonais, Tchèques recevant d’autre part des colis familiaux, la vie dans ces Blocks était d’un niveau très différent.
Au total, 250 personnes sur 13 000.
7° REVIER :
On a suffisamment décrit les hôpitaux des différents camps : ils sont tous pareils, un semblant d’organisation médicale avec prise de radio, etc. mais formant en réalité l’arrêt de mort du sujet. Dans les cas de maladies, aucun soin, conditions de coucher, de propreté infectes, sélections continuelles, piqûres « Bahnoff » où l’on mettait les malades à qui l’on ne donnait plus de nourriture. C’est tellement intéressant comme bénéfice pour le personnel du Block, tous ces départs en transport n’allant nulle part, le gazage de Blocks entiers.
Quelques médicaments mais faut-il dire, alimentant le marché noir, au profit des infirmiers et Kapos.
8° PROCÉDURE D’EXTERMINATION :
- COUPS : Mains nues – schlague – n’importe quel moyen.
- BASTONNADE : Flagellation – schlague ou bâton (25 à 150 coups), punition la plus usuelle.
- APPEL : Durée indéfinie au garde à vous par n’importe quel temps : soleil, pluie, neige.
- FROID : Insuffisance vestimentaire, aucun chauffage.
- DOUCHE : Eau froide à large dose entraînant la mort.
- MANQUE DE NOURRITURE : Famine continuelle – Aliments avariés – Soif étanchée avec de l’eau corrompue provoquant la dysenterie.
- DÉSINFECTION : Mise en scène causant plus de pertes aux détenus qu’aux poux. Mise à nu pendant des journées entières. Attente de douches. Sélection.
- TRAVAIL DANS L’INDUSTRIE DE GUERRE : Pour des pièces cassées, ratées ou insuffisance de production, menu vol, accusation de sabotage formulée souvent par des civils entraînant coups, tortures jusqu’à la pendaison.
- TRAVAIL DANS LES TUNNELS : Effondrements fréquents causant de nombreuses victimes, ceux-ci presque quotidiens.
- ABSENCE DE SOINS : Le malade est par excellence à éliminer.
- CHIENS : Utilisés pour les transports, les gardes nocturnes et pour accélérer la marches des détenus aux abris.
- CACHOTS ET TORTURES : Avec ou sans prétexte, séjour au cachot avec la « question », absence totale de nourriture.
- PIQÛRES : Moyen utilise pour vider régulièrement le Revier.
- GAZ : Soit dans le car-fantôme, soit dans des Blocks entièrement gazés (notamment les Blocks 16, 24, 31).
- ALERTES : Prétexte au séjour dans des abris provoquant un état de faiblesse général, avec utilisation des coups et chiens.
- FUSILLADES : À GUSEN, seulement de Russes et de Polonais.
- SUICIDES FORCÉS : Comme dans les autres camps.
* transcription d’un témoignage oral à partir de notes prises en sténo et non relu, d’où potentiellement quelques erreurs.
fac-similé disponible dans Regards croisés sur le camp de concentration nazi de Mauthausen, Archives – Mémoire – Histoire, éditions Amicale de Mauthausen, coll. Cahiers de Mauthausen, 2010 : document n°3, p. 214-222 – En vente à l’Amicale
↑ haut de page ↑
Loibl Pass
Robert ZARB, Simon LAUVERGNAT et Yves DROMARD
Robert ZARB :
Nous avions été envoyés dans ce Kommando pour creuser un tunnel, entre l’Autriche et la Yougoslavie. Des mineurs spécialisés étaient chargés de poser les charges et d’étayer la galerie ; nous devions déblayer et installer des bâtiments tout autour.
Le tunnel : une demi-heure de marche pour gravir une côte terriblement raide et au pas. Partir avec un quart d’eau chaude et noire dans le ventre, travailler sans répit tout en étant battu comme des bêtes, sans aucun motif, jusqu’à 11 h 45, redescendre au camp, recevoir un litre de soupe qu’on va manger dans un coin, lentement, sans parler, après s’être bousculés pour pouvoir passer vers la fin du bidon ; la soupe étant un peu plus épaisse. On mange lentement pour que ça dure plus longtemps, on ne pense pas, on essaye de se faire petit, de passer inaperçu, pour ne pas recevoir un coup de schlague. La gamelle finie, on se rend aux lavabos pour la laver, il faut faire vite, il y a toujours un allemand, une matraque en main…
Une heure, Arbeit Kommando Formieren on repart, la côte est raide, il fait chaud et il faut marcher au pas : Links, zwei, dreï, vier, Schneller. […] Nous marchons, il ne faut pas flâner, sinon un coup de crosse vous rappelle à l’ordre et un Kapo vient compléter la chose. Nous arrivons enfin sur les chantiers, appel encore une fois, et travail : pelles, pioches, brouettes à charrier, wagonnets à remplir de sable et à pousser, lourds panneaux à transporter, camions à décharger, sacs de ciment de 50 kg à charger, gros blocs de pierre à soulever, troncs d’arbres à enlever.
Nous sommes à bout, et il faut continuer. Vous êtes en train de travailler de votre mieux, passe un SS et vlan, il vous tapera dessus sans la moindre raison, un Kapo en fera autant et il faut tout encaisser sans rien dire : se révolter serait signer son arrêt de mort et nous tenons à vivre. Ajoutez la faim, la soif, la fatigue, depuis le matin jusqu’au coucher, nous vivons dans un cauchemar perpétuel, ce ne sont que coups, cris, lourds travaux…
Simon LAUVERGNAT :
Le travail se faisait en deux équipes de dix heures, une semaine de jour, une de nuit. Quand on travaillait de nuit, il n’y avait guère de repos, car nous étions souvent dérangés pour des corvées à effectuer, surtout en hiver. Les avalanches étaient nombreuses et il fallait déblayer la neige sur la route. Les conditions de vie étaient très dures. Le Block n’avait que le chauffage humain et il faisait souvent moins vingt degrés, avec des chutes de neige très importantes. En déblayant un mètre entre les Blocks, on ne voyait pas d’un Block à l’autre. Les fenêtres, pourtant en double vitrage, étaient recouvertes d’une belle épaisseur de glace. Les latrines et les lavabos étaient au milieu du camp. C’était une installation des plus rudimentaires : une fosse de plus de deux mètres de profond avec une poutre dessus comme siège et une autre comme dossier. Les lavabos, c’était une rampe de robinets sur une longue cuvette et malgré tout, il y avait intérêt à être propre pour éviter les brimades. Les lits étaient à deux étages avec des paillasses garnies de frisons de bois quasi en poussière et deux couvertures très usagées.
Le tunnel se trouvait orienté nord-sud : quand le vent venait du nord, il y avait beaucoup de courants d’air très froid. Comme il y avait un risque d’éboulement dans la roche noire comme du charbon, la voûte était bétonnée à mesure de l’avancement. Le creusement se faisait tout à l’explosif, il fallait déblayer dans la fumée nitrée, ce qui était particulièrement irritant pour les bronches.
Yves DROMARD :
Il doit être cinq heures du soir quand nous arrivons à une petite gare, terminus de la ligne. C’est Neumarktl [ndlr : nom donné par les Allemands à Tržič], nous y débarquons.
Dans la cour de la gare, nous nous rassemblons toujours colonne par cinq. On nous compte et nous recompte. De nouveau, des SS prennent livraison de nous, symptôme bien fâcheux. Un gamin de dix à douze ans, en costume hitlérien, nous dévisage avec un mépris non dissimulé, qui pour ma part me laisse assez indifférent. Il tourne autour des soldats.
Peu à peu la population se montre. Quelqu’un du pays parlemente avec l’officier pour obtenir de lui la permission de nous donner du pain. L’officier accepte. Aussitôt deux pleines corbeilles de pain nous sont distribuées, ainsi que des cigarettes, des pommes. Nous n’en croyons pas nos yeux, ne sachant pas encore où nous sommes, de l’aménité attendue des SS, de la générosité des habitants. Voilà l’explication : nous sommes en Yougoslavie, à une quarantaine de kilomètres de Ljubljana (Laybach en allemand), en Carinthie, dans les monts Karawanken.
Des camions arrivent dans lesquels s’empilent les premiers rangs. Je ferai partie du deuxième voyage. Une heure après environ, j’embarque à mon tour pendant que les Slovènes nous font de grands gestes d’amitié et que quelques femmes furtivement se signent.
Une dizaine de kilomètres, une route qui monte sans cesse nous amène dans un cirque de montagnes dont la seule issue semble être la route que nous avons prise. Au fond d’une prairie, nous voyons un camp qui, hélas, ressemble comme un petit frère à celui que nous venons de quitter : même enceinte de hauts poteaux barrés de barbelés, même miradors, mêmes baraques… À gauche de la route, devant ce camp, se trouve celui des SS. À droite, deux ou trois baraques et d’autres en construction forment le camp civil et celui des Polizei.
Appel, on nous compte, on nous recompte, puis nos manteaux et nos moufles nous sont enlevés. Nous sommes scindés en deux groupes. Des Kapos font des discours. Ce sont nos chefs de Block qui se présentent à nous. Le mien s’appelle Eddy. En substance il nous dit ceci : « Vous êtes ici pour obéir et pour travailler. Vous n’avez aucun droit, que celui de vous taire. Vous crèverez tous ici ». Cet accueil nous réchauffe évidemment le cœur. […]
Nous, les nouveaux, nous restons dans le camp pendant que les anciens s’en vont sur le chantier situé à une bonne centaine de mètres plus haut que le camp et à deux kilomètres environ. […]
Une quinzaine de jours après notre arrivée, nous attendons trois camions qui doivent nous emmener, par-delà le col, sur l’autre versant de la montagne, pendant que nos camarades montent comme d’habitude au chantier. Après une montée vertigineuse, après des virages en épingle à cheveux, nous voici au col que surveillent quelques Polizei, une descente de trois ou quatre kilomètres et nous rejoignons le fond d’une vallée encaissée où coule un maigre ruisseau. Nous débarquons à un coude de la route d’où part un sentier très raide. Nous nous y engageons et après quelques centaines de mètres nous arrivons sur le nouveau chantier.
Nous allons préparer le terre-plein de baraques qui s’élèveront là dans le futur. Il faut débarrasser la place des arbres abattus, des branches, etc. Le Kapo Herbert n’est pas des plus commodes. Heureusement nous sommes divisés en deux équipes dont l’une se dirige vers l’entrée du tunnel, située en contrebas dans une vallée. Herbert sera donc obligé de se partager et nous ne l’aurons guère qu’une moitié du temps sur le dos. Je pousse une brouette. Tant qu’il ne faut pas aller la vider trop loin, ça ira, après je verrai. Mes mains ont du mal à s’habituer à ces travaux, j’attrape des ampoules mais pas la moindre trace de cal.
À midi, nous redescendons le chemin et rejoignons la route où nous attend la soupe amenée par un camion, puis de une heure jusqu’à six heures et demie de travail. Les camions viennent alors nous rechercher. […]
Ces voyages du sud au nord durent environ deux mois, jusqu’à la fin de septembre. À ce moment-là, le chantier nord a bien changé d’aspect : des arbres sont tombés par centaines, l’entrée du tunnel se trouve placée de plain-pied maintenant avec le terre-plein composé des déblais retirés du tunnel dont on a comblé le fond de la vallée. À droite et à gauche pour agrandir la plateforme nous creusons les flancs de la montagne.
C’est à cette époque-là que nous quittons définitivement le camp sud pour le nord où une baraque, destinée plus tard aux civils, nous est provisoirement affectée. […]
Le versant nord, comme il se doit beaucoup plus triste que l’autre, est aussi beaucoup encaissé entre les montagnes. Le soleil fait une brève apparition au-dessus des sommets dentelés qui bornent de près notre horizon. Toutefois, en se mettant au bord du terre-plein, le dos au tunnel, la vue se dégage un peu sur un pays très montueux, très boisé, sauf les pentes exposées au midi sur lesquelles se trouvent quelques fermes et pâturages. Le temps, qui était chaud jusqu’aux derniers jours de septembre, fraîchit et, vers le 8 octobre, est tombée la première neige. Les sommets en sont coiffés. Nous ne savons pas encore à quel terrible ennemi nous allons avoir à faire face.
Robert ZARB dit Robert BOERINGER, matricule 27 049 (Mauthausen, Loibl Pass)
Simon LAUVERGNAT, matricule 62 658 (Mauthausen, Melk, Loibl Pass)
Yves DROMARD, matricule 27 989 (Mauthausen, Loibl Pass) – extrait de J’étais le numéro 27989 au Loibl Pass, le camp oublié, Yves Dromard ; livre envoyé à l’Amicale par sa fille, le 21 septembre 2011, accompagné d’un courrier : « En 1951, lors d’une hospitalisation consécutive à sa déportation, il a finalisé la rédaction d’environ 150 pages manuscrites dont il ne nous a parlé et qu’il ne nous a laissé lire que tardivement. Aujourd’hui, mes frères et moi-même avons publié ses écrits à compte d’auteur […]. »
↑ haut de page ↑
Melk
Ernest VINUREL, Raymond HALLERY et René GILLE
Ernest VINUREL :
Je passai pour la première fois le portail grand ouvert du nouveau camp. Les sous-officiers qui nous attendaient appartenaient, pour certains, à la SS et, plus nombreux, à la Luftwaffe. Mützen ab ! Mützen auf ! On exécutait les ordres sans y attacher la signification de respect et de soumission que les SS croyaient nous avoir imposée. Simplement parce qu’il aurait été dangereux de ne pas s’y plier.
Sur la droite, s’étendait un grand espace en triangle, désert en ce moment, qu’entouraient sur deux côtés les bâtiments et dépendances de la caserne, et un grand hangar en bois sur le troisième. Les détenus de l’équipe de jour étaient partis au travail ; ceux qui travaillaient de nuit étaient dans les baraques. Sur la place, un peu à l’écart, se tenait un petit groupe de détenus : chacun d’eux, je n’allais pas tarder à m’en rendre compte, jouait un rôle déterminant dans la vie du camp et par conséquent ces hommes-là furent pour beaucoup dans mes conditions de vie à Melk. Celui qu’on remarquait d’abord, c’était un détenu allemand, herculéen, une véritable force de la nature. Il bavardait avec deux hommes qui portaient sous le bras des dossiers et une boîte à fiches. Autant l’Allemand était grand et blond, autant les autres étaient petits et noirauds. Ils portaient le triangle rouge des politiques cousu à la veste avec la lettre « F » : c’étaient les deux premiers Français que je voyais en chair et en os. […] Les deux spécimens que j’avais devant moi ne m’ont pas déçu. L’un d’eux était Antoine (ou Antonin) Pichon ; l’autre, je crois, Fougerousse. Ils travaillaient ensemble au Schreibstube, le secrétariat du camp.
Pichon occupait la fonction de Lagereinsatzschreiber : c’est lui qui avait la charge de constituer les différents Kommandos de travail selon les demandes des entreprises et d’y affecter des détenus – l’un des postes les plus importants, on s’en doute, parmi les déportés du camp. Il jouissait, j’en prendrais la mesure peu à peu, d’un prestige indiscuté parmi les Français. […] L’Allemand Hofstädt, Lagerschreiber – la plus haute fonction dans la hiérarchie des détenus – était un avocat de Westphalie, militant chrétien-démocrate. Il n’était pas particulièrement connu à Mauthausen pour son engagement politique. Après plusieurs années de prison à Berlin, il fut transféré à Mauthausen où il fut affecté à l’administration du camp comme secrétaire du capitaine SS Schütz, qui avait besoin d’un spécialiste des impôts. Quand, en 1944, Schütz fut muté à Auchwitz, il fit nommer Hofstädt, par le Lagerschreiber de Mauthausen, au même poste dans le Kommando qu’on ouvrait à Melk. Le secrétariat de Mauthausen, qui se débrouillait habituellement pour recommander les Lagerschreiber des nouveaux Kommandos, était dirigé par des politiques : le Tchèque Pany, l’Espagnol De Diego, l’Autrichien Marsalek. Ils avaient réussi à se débarrasser du criminel Leitzinger, le premier Lagerschreiber. Hofstädt, qui n’était pas communiste, ils ne le connaissaient pas, mais ils ne pouvaient rien contre la recommandation de Schütz, ni donc s’opposer à sa nomination. C’est ainsi que Pichon et Hofstädt, ces deux détenus que rien ne destinait à travailler ensemble, ni leurs origines, ni leur sphère idéologique, qui n’avaient en commun que leur haine intransigeante et viscérale envers le nazisme, ont œuvré en parfaite entente, devenant les deux meilleurs défenseurs des détenus face à l’autorité du camp – de tous les détenus, sans distinction nationale, religieuse ou politique. Pichon, qui courait le risque permanent qu’on ne découvrît son origine juive (son vrai nom, André Ulmann, je ne l’ai connu que bien plus tard, après la libération), ne pouvait pas s’engager aussi ouvertement qu’Hofstädt (de « sang aryen pur ») pour atténuer le sort particulièrement difficile des détenus juifs. Sur la fiche d’internement concernant ce dernier, établie par la Gestapo, figurait déjà la mention (qui était l’un des motifs de son internement) : « Fréquente les juifs ».
Raymond HALLERY :
Le Kommando de Melk tient une place particulière dans l’histoire de Mauthausen. Les conditions générales de vie, ou plus précisément de survie, étaient les mêmes que dans les autres Kommandos, travaux exténuants, manque de nourriture, brutalité des S.S., manque de sommeil, de soins, etc. pourtant les conditions d’existence des Français qui y séjournèrent furent telles que le pourcentage des morts est relativement plus faible qu’ailleurs. Deux facteurs essentiels en sont la cause :
a) Ce Kommando fut créé fin avril 1944 – le premier convoi qui commença par construire le camp autour des casernes S.S. existantes était de cinq cents déportés, presque tous Français, à l’exception de quelques dizaines d’Espagnols et d’Allemands, ces derniers destinés à constituer l’encadrement, mais comprenant un certain nombre de « politiques ». La composition de ce convoi avait été déterminée par l’organisation clandestine du camp central.
– De ce fait de nombreux Français purent accéder à des postes dans l’administration du camp et dans les services généraux. C’est ainsi qu’André Ulmann, dit Antonin Pichon, fut « Lagerschreiber » pendant toute la durée du camp ; d’autres furent chefs de Block, Kapos. À l’infirmerie, aux cuisines et à la désinfection, dans les services d’entretien, les Français étaient nombreux.
– Cette situation était favorable pour tous ceux qui occupaient de tels postes, mais également pour l’ensemble des Français. Le rôle d’André Ulmann fut déterminant. Lui et son adjoint André Fougerousse ne reculèrent jamais devant leurs responsabilités pour sauver le maximum de déportés en général, mais surtout les Français, les Espagnols, les Belges etc. Ils le firent avec intelligence, sans pour autant échapper aux coups des S.S., mais abréger un appel, empêcher les réveils pour « contrôle des poux », affecter à tel ou tel poste ou Kommando moins dur, c’était sauver des camarades. Ils purent faire tout cela parce que le collectif français présentait certaines caractéristiques qui constituent un second facteur.
b) Les Français, arrivés les premiers à Melk, n’étaient pas des isolés. En effet, parmi eux, on trouvait des résistants arrêtés depuis longtemps et ayant séjourné ensemble dans diverses prisons et camps de France occupée. C’était le cas d’environ soixante – quinze militants communistes passés par la « prison universelle » de Blois, avec parmi eux Auguste Havez, qui, en liaison avec André Ulmann, joua un rôle décisif dans la sauvegarde des vies françaises : disposant d’une organisation clandestine efficace, les déportés communistes ne se bornèrent pas à organiser la solidarité entre eux, mais ils l’élargirent à tous les ressortissants français. Ils contribuèrent d’une façon décisive à créer un organisme clandestin à l’image du Front National en France.
– Cela fut rendu plus facile du fait qu’en dehors des communistes, d’autres groupes existaient : certes, ils n’avaient pas l’organisation des premiers, mais formaient des ensembles homogènes. C’est ainsi qu’il y avait quelques dizaines de résistants catholiques rassemblés autour de l’abbé Jean Varnoux. On comptait également un groupe d’une dizaine d’officiers résistants et aussi un groupe de résistants de la région de Grenoble, Annecy, Lyon, passé par le Fort de Montluc, où il s’était soudé. Enfin, il faut ajouter que nous avions passé ensemble plusieurs semaines au camp de Compiègne, ce qui avait donné le temps de nous connaître.
René GILLE :
L’usine souterraine de Roggensdorf, en pleine construction, nécessite de plus en plus de main-d’œuvre. Bientôt sept mille hommes au moins se succèderont de zéro à vingt-quatre heures, en quatre équipes de mille cinq cents à deux mille hommes chacune. Amener les forçats sur le chantier par camion exige trop de matériel. Les faire venir à pied présente au moins l’inconvénient de faire perdre du temps, la question de la fatigue n’entrant pas en ligne de compte. Or, Roggensdorf se trouve sur la grande ligne des « Metropa » [il s’agit sans doute des Mitropa, abréviation de la Mitteleuropa, compagnie de restauration des chemins de fer allemands] et le transport par chemin de fer se présentant comme le plus pratique, nos maîtres en viendront à construire des quais d’embarquement et de débarquement de la chiourme, l’un à proximité de la gare de Melk, l’autre à Roggensdorf même, à proximité de l’usine.
Un train de « quarante hommes – huit chevaux » circulera sur cette portion de ligne de mai 1944 à avril 1945, toujours le même qui, entre les services, est stoppé sur une voie de garage à Loosdorf. Les forçats feront donc le trajet en quelques minutes, debout et au moins pendant ce temps à l’abri des intempéries. Le ballast étant en remblai et haut de quelques 5 ou 6 mètres, par rapport à la plaine, il s’agira de construire de chaque côté de la voie un quai d’embarquement, soit deux près de Melk et deux à Roggensdorf. Ils auront 250 mètres de long chacun, sur 6 ou 7 mètres de large, construits entièrement en bois. Travail qui nous semblait gigantesque et cependant nous achèverons plus de 900 mètres de quais en moins d’un mois, alors que nous ne serons jamais plus de trente en équipe, en travaillant seulement le jour.
Ernest VINUREL, matricule 71 329 (Mauthausen, Melk) – in Rive de cendre, p. 249-251, Ernest Vinurel, Éditions L’Harmattan, coll. Mémoires du XXe siècle, 2003
Raymond HALLERY, matricule 62 521 (Mauthausen, Melk, Ebensee) – in Le neuvième cercle, Mauthausen, Christian Bernadac, tome 2, p. 319-320, Paris, Éditions France Empire, 1975
René GILLE, matricule 62 451 (Mauthausen, Melk, Ebensee) – in Le neuvième cercle, Mauthausen, Christian Bernadac, tome 2, p. 272-273, Paris, Éditions France Empire, 1975
↑ haut de page ↑
Steyr
José BORRÁS
Le premier groupe espagnol placé dans l’industrie de guerre fut celui composé de trois cents républicains qui partit créer le 6 janvier 1942 le Kommando Steyr et fut mis à l’œuvre immédiatement dans la construction d’une usine de moteurs d’avions, appartenant à la firme Steyr-Daimler-Puch AG. Cette firme représentait un important complexe d’armement éparpillé dans toute l’Allemagne, employant avant la guerre plusieurs milliers de salariés et beaucoup plus de déportés pendant les années 1942-1945.
On y fabriquait des armes de toute sorte : fusils-mitrailleurs, roulements à billes, cabines et moteurs d’avions, camions et chenillettes, et on essaya les moteurs d’avions fabriqués sous terre par des dizaines de milliers de déportés des camps de Dora, Ebensee et autres.
À Steyr, ils étaient désignés pour la construction de routes, de bâtiments, d’abris antiaériens et pour la fabrication à la chaîne ou sur des machines par des spécialistes de précision, tourneurs, fraiseurs et autres aléseurs.
Lors des bombardements américains de février et avril 1944, les ateliers de Steyr et de Münichholz furent gravement endommagés et la production déménagea vers les camps de Wien, Linz, Graz, Alfenz, Peggau et Ebensee.
Florencio de la Fuente, qui fit partie de la première expédition de Steyr, dit qu’à partir de janvier 1942, son groupe faisait journellement l’aller et retour pour y construire les futures installations du camp.
Nous partions à six heures du camp central. Les descentes de la colline étaient dures mais les retours meurtriers.
Rare était le jour où nous rentrions sans morts, sans morsures de chien ou sans blessure par baïonnette, sans compter la balle dans la nuque lorsqu’à la queue de la colonne un vieux ou un trop faible ne pouvait plus avancer. Car la joie des Kapos et des SS était de faire monter la colline à marches forcées.
Les miradors ainsi que le barbelé électrifié furent construits par nous mais à coups de fouet et de pointes de baïonnette. Nous allions chercher les poteaux de trois mètres souvent en courant sur terrain enneigé et par un froid de moins quinze degrés.
Les groupes de travail avaient été formés dès le premier jour pour faire le terrassement et préparer les fondations de ce qui devait être la future usine d’essais de moteurs d’avions.
Dix heures sur le chantier éclairé électriquement et trois ou quatre pour aménager le camp, y construire les routes, la place d’appel avec la pierre transportée lors du dernier voyage de retour au camp faisaient que ces travaux avançaient au pas de course, les morts s’y comptaient chaque jour, et les rares qui y survécurent en ont toujours parlé comme d’un mauvais cauchemar.
José BORRÁS, matricule 4 106 (Mauthausen, Steyr) – in Histoire de Mauthausen. Les cinq années de déportation des républicains espagnols, éditions J. Borrás, 388 p., 1989
↑ haut de page ↑