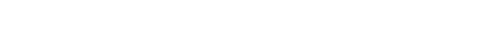Jean CAYROL, Rémy GILLIS
composé et chanté à Gusen en mars 1944
Une action singulière de résistance au camp
À la mémoire de Serge Choumoff, qui aimait exalter l’aventure de ce chant, et du groupe des jeunes Français qui, les premiers, l’entonnèrent.
Une pièce méconnue du patrimoine historique
En dehors des cercles de la mémoire (francophone) de Mauthausen, le Chant d’espoir est rarement entendu et il est souvent ignoré par les anthologies de chants composés dans les camps.
Notre émotion fut vive de l’entendre à Bayeux, en novembre 2016, interprété par la Chorale gourmande, à l’occasion de notre congrès.
Tous ceux qui ont commémoré, sur les sites du camp de Mauthausen, en mai 2000, le 55ème anniversaire de sa libération, se souviennent que le Chœur d’hommes d’Anjou fit sonner ce chant sous les ors baroques de l’église abbatiale de Melk, d’où l’on entrevoit le camp nazi, annexe de Mauthausen, installé dans une caserne en 1944-1945, sans que se brisât le silence des moines.
La beauté atypique du Chant d’espoir ne se laisse pas aisément déchiffrer. Le chant n’évoque pas directement le camp, et même il nous en dérobe la réalité, parce qu’il n’est pas tourné vers nous : il ne s’agit pas d’un témoignage, au sens usuel du terme. Si l’on entreprend de cerner les circonstances de sa création, ce chant nous fait entrevoir des vérités du camp que les discours historiques et même les récits de rescapés abordent peu.
Les circonstances : Gusen I, ateliers Steyr, mars 1944
Un petit groupe de détenus : des Italiens, des Belges, des Français. Les instants qu’ils peuvent arracher à la surveillance, ou certains dimanches, quelques-uns griffonnent des poèmes, tandis que parfois un semblant d’orchestre joue pour les gardiens.
Le Chant d’espoir est né dans ce contexte extrêmement précaire, difficilement imaginable.
Comment se représenter ce temps volé, plus encore ce qui relève de la création artistique, à Gusen ? En principe, tout fait défaut, le papier, l’énergie, le minimum de disponibilité mentale pour se retrouver seul avec soi-même ou avec les autres. Quelques études récentes éclairent cette zone mal connue : non seulement les SS ont imposé des prestations « artistiques » (qui donc n’en sont pas), mais aussi, dans la nuit des baraques et clandestinement, des gestes artistiques et les impondérables instants d’élévation qu’ils procurent ont échappé à la logique du système. Sur ce point, tous les camps de concentration nazis n’offrent pas les mêmes possibilités – Gusen, comme Mauthausen, furent parmi les plus oppressifs. Et pourtant, même en ces lieux, des parcelles de liberté mentale ont trouvé à s’exprimer : le film du Tchèque Vojtěch Jasný J’ai survécu à ma mort (1960) propose sur cette réalité de Mauthausen quelques scènes stupéfiantes, que les déportés français ont validées.
Jean Cayrol, Rémy Gillis
Cayrol, âgé alors de 33 ans (et mort en 2005), est un poète confirmé, d’inspiration catholique, éveillé à son art dans la mouvance surréaliste. Membre d’un réseau de résistance gaulliste, il a été arrêté à Bordeaux en juin 1942. Après dix mois de détention à Fresnes, il est déporté vers Mauthausen le 25 mars 1943 (malgré les interventions d’Aragon, Paulhan et même Drieu la Rochelle), sous le régime « NN » (un cran de plus de la répression, désignant ceux qui doivent disparaître « dans la nuit et le brouillard », Nacht und Nebel, des mots venus sans doute de Wagner). Il est transféré à Gusen le 7 avril.
D’abord affecté à une carrière (« Je fus, pendant des mois, esclave d’un marteau-piqueur, puis d’une fraiseuse. Ma santé chancelait. Le pus me recouvrait les mains. » écrit-il en 1982), il est soutenu et fasciné par le père Gruber, un prêtre autrichien détenu, auquel sont octroyées quelques espaces de liberté et qui sera supplicié en avril 1944. Cayrol obtient une affectation plus protégée, dans les ateliers Steyr. Il écrit, en vers libres, des textes longtemps perdus et finalement publiés en 1997, sous le titre Alerte aux ombres, 1944-1945. L’auteur explique en préambule qu’il « se refuse à considérer comme des poèmes » ces textes « écrits dans un atelier d’une petite usine du camp de Guzen [sic] – Mauthausen. Les détenus y vérifiaient des pièces entassées sur de grandes tables. En se cachant sous ces abris relatifs, l’auteur écrivait dans la pénombre, sans se relire, pendant que le travail se poursuivait au-dessus de lui ».
A fortiori, écrire les paroles du Chant d’espoir ne pouvait être pour lui une activité proprement poétique. D’ailleurs, aux temps modernes, les paroles d’une chanson sont d’une autre nature, n’ayant d’existence que portées par la musique, tempo, mélodie et accompagnement instrumental éventuel. C’est vrai aussi dans le cas d’un poème préexistant choisi par le musicien, ramené au registre expressif et au format d’une chanson.
Gillis a 34 ans, et l’esprit bien trempé. Belge de père francophone, Anversois par sa mère, il fut instituteur dans cette ville, puis professeur d’allemand jusqu’en 1939. Musicien autodidacte, il compose des partitions, notamment des chansons pour enfants. Syndicaliste et militant communiste, il a participé aux luttes sociales des années trente, à l’accueil des Allemands antinazis, à celui des enfants de républicains espagnols pendant la guerre civile. Dès l’occupation allemande en 1940, ses engagements politiques le conduisent à organiser des groupes de sabotage. Entré dans la clandestinité en 1941, il devient membre de la direction nationale du Front de l’indépendance. Arrêté sur dénonciation en 1942, il est interné au fort de Breendonk, près d’Anvers, qu’il décrira plus tard comme un enfer – il y subit la faim et la torture, on lui casse toutes les dents. Fut-il, comme certaines notices l’indiquent et d’autres sources le contestent, l’auteur du Chant de Breendonk, écrit en néerlandais, qui circula de bouche à oreille ? Il semble que non.
Rémy Gillis, déporté à Mauthausen en novembre 1942, sous le régime NN, est transféré à Gusen où, grâce aux communistes allemands détenus, il est affecté au Bauburö (bureau de la construction), devient traducteur et occupe un poste privilégié : « Chaque jour, il doit mesurer le niveau du Danube et de la nappe phréatique : la ville d’esclaves créée par les nazis, il faudra bien l’alimenter en eau. » (rapporte son fils cadet, né en 1951).
Rentré de déportation, il écrit toujours des chansons. Les papiers griffonnés qu’il a rapportés sont aujourd’hui déposés aux Archives du royaume. Il ne reprend pas l’enseignement, effectue des séjours à Moscou, et plus tard plusieurs voyages en Corée du nord (où une rue de Pyongyang, dit-on, porte son nom). Il meurt en 1983.
« Nous gardons de lui – écrit son fils – le souvenir d’un personnage hors du commun, sympathique, amoureux de la vie, aimant les femmes, les chansons, la musique, les voyages, les fêtes, la politique, les camarades, le vin, le sport, l’aventure, les expériences de vie et détestant les conflits. Il était un séducteur dans le bon sens du terme, il réglait les problèmes avec le sourire et préférait convaincre que vaincre ».
Cayrol et Gillis : quel attelage, si on le voit comme celui d’un admirateur de la Corée du nord en binôme avec un catholique fervent ! Cette représentation serait foncièrement anachronique : d’une part, l’alliance la plus large s’impose contre la barbarie nazie, ce qu’atteste le large spectre unifié dans la Résistance française ; d’autre part, la condition de concentrationnaire a érigé entre des déportés d’origines et de personnalités les plus dissemblables une valeur cardinale de « fraternité ». Le poème d’Aragon La rose et le réséda – le plus fameux écrit en français durant les années noires, avec Liberté d’Éluard – dont un extrait est gravé dans la pierre du Monument des déportés à Bayeux, est l’affirmation la plus mémorable de cette alliance qui bousculait les anciens antagonismes. Elle s’incarne exactement dans la relation nouée entre Jean Cayrol et Rémy Gillis : Celui qui croyait au ciel / Celui qui n’y croyait pas / Fou qui songe à ces querelles / Au cœur du commun combat…
Chanter l’« espoir » à Gusen
Rappelons l’accueil du commandant du camp à l’arrivée de chaque convoi : la cheminée du crématoire est la seule issue. De fait, un quotidien sans horizon, jusqu’à la mort promise : travail harassant (destiné à l’être), faim, violences, hiérarchie destructrice entre détenus eux-mêmes, maladie, l’arbitraire pour seule loi (« Ici, il n’y a pas de pourquoi »). Les épuisés sont éliminés, de toutes les façons, y compris au Revier (infirmerie) : faim, insalubrité et violences aggravées, « sélection » des plus faibles pour la piqure d’essence dans le cœur ou le gazage collectif.
Chanter l’espoir, c’est la culture des esclaves. Mais à Gusen, même dans cette zone un peu protégée des ateliers Steyr ? Un papier où était noté le Chant d’espoir circula, camouflé dans un carton émanant du Bauburö. Examinons la texture de la chanson.
Les paroles tissées par Cayrol. Elles déréalisent : la détention est évoquée dans une généralité floue (toute une vie prisonnière, nos prières, les maudits noms de nos prisons) qui édulcore la situation subie. Le texte construit une opposition entre présent et futur, qu’accentuent la scansion des verbes conjugués, le domaine double des vivants et des absents (les morts ? des doubles inaccessibles ?), et que dramatisent les possessifs nous, nos. Une fois un sujet singulier, je, mes deux mains, ton premier visage d’enfant et l’inattendu mes frères, étranger au langage habituel des camps (et sans doute à celui de Gillis) : les déportés sont des camarades, parfois des compagnons. La plus grande part du texte est la désignation d’un ailleurs hospitalier, idyllique : maison, pain blanc, amour vin tabac, saisons, printemps, liseron, vergers pleins de lumière, fruits, chanson.
Cette imagerie irréelle, de type naïf, étonne venant d’un poète plus exigeant, par exemple dans les textes d’Alerte aux ombres. Mais une chanson, c’est une autre affaire.
Cayrol publiera en 1948, dans la revue Les temps modernes, un essai intitulé Les rêves concentrationnaires, que le philologue autrichien Peter Kuon aborde comme l’« une des études les plus précoces et les plus originales sur les défenses psychiques du déporté ». Il souligne que Cayrol dit avoir pratiqué à Gusen la « cueillette de rêves » ! Or l’analyste des récits concentrationnaires observe que, pour beaucoup d’entre eux, les survivants du camp ont craint leurs rêves, les cauchemars bien sûr, mais plus encore le danger de se laisser envahir par le doux rêve du passé, signe « du dépérissement physique, […] de l’abandon du monde réel et signe avant-coureur de la mort ». Kuon formule ainsi l’alternative vitale : « se protéger du désespoir par les souvenirs et les rêves ou se protéger des souvenirs et des rêves pour ne pas désespérer ? ». L’analyste débusque dans les énonciations contournées de Cayrol sur ce point l’aveu difficile d’une vérité que percevait aussi, sans lui accorder spécialement d’attention, dans une publication de 1947, Viktor Frankl, psychiatre autrichien déporté à Auschwitz : l’influence positive du rêve est réservée au petit nombre de ceux ayant pu préserver leur équilibre psychique. Ceux qu’accepte de désigner Cayrol : « les initiés dont nous faisions partie ». Kuon conclut, pour saisir la démarche du poète : « On peut se demander alors, si cette idée, qui pourrait paraître incongrue dans un camp de concentration, de « cueillir » les rêves, comme si le rêve était le remède au mal et la clef du salut, ne vient pas d’une autre expérience professionnelle, celle du poète, surréaliste de surcroît ».
La mélodie composée par Gillis. Des intervalles d’une octave, un ambitus de onzième (une octave augmentée d’une quarte), ce n’est pas le tout venant de la chanson : le Chant d’espoir est moins aisément chantable que le Chant des marais, et même que La Marseillaise, qui est, musicalement, un hymne d’une ambition audacieuse, caractéristique du moment historique qui l’a enfanté. Chacun peut le mesurer : dans la mélodie du Chant des marais, ou dans celle du God save the Queen, faciles à chanter, les écarts entre les notes sont réduits, pas d’intervalle supérieur à une quinte. D’un autre point de vue encore, en dépit des interprétations plus récentes, la mélodie écrite par Gillis n’est pas celle d’une complainte : il faut imaginer à sa création à Gusen une scansion plus entraînante sans doute que les interprétations mémorielles, qui privilégient fatalement la gravité (voir l’indication sur la partition, produite évidemment après coup et dans cette perspective : « Solennel »).
Ils se sont approprié le Chant d’espoir !
Comment concevoir cette aventure, vécue à Gusen, par des hommes épuisés et sur le qui-vive ? L’espoir se nourrit de l’effort de chanter une mélodie malaisée, dans la superposition approximative, observable à plusieurs reprises dans les couplets, du rythme naturel de la syntaxe et du phrasé musical. Ils absorbèrent l’énergie contenue dans les intervalles audacieux, ils firent face à l’effort demandé pour proclamer ces mots-là, plus exactement se les entrer dans la cervelle ! Une chanson, telle un rêve éveillé ? Le pouvoir de déréalisation, vers le dépassement de soi, accompli par le fait de chanter ensemble, de scander ces paroles, partagées comme le pain – il y a du religieux dans le geste, une magie, sinon une transcendance.
Il fallait un poète pour avoir cette foi dans le pouvoir des mots ; il fallait cet instituteur militant pour croire en ce qu’on peut demander à des hommes en état de déréliction extrême, qui soit capable de les relever. Cayrol n’avait pas craint d’être pauvre en outils d’expression. Il fallait accoler les mots de la vie, ramenés à leur plus simple appareil et reliés par des rimes approximatives – non pas du fait des conditions d’écriture, puisque les poèmes d’Alerte aux ombres sont contemporains et d’une facture plus académique. Le Chant d’espoir des bagnards de Mauthausen n’est pas une œuvre de mémoire à proprement parler, destinée à porter témoignage dans l’avenir. Ce fut un chant de survie, à fonction immédiate.
Sans doute l’expérience ne fut-elle pas aussi concertée que l’analyse conduit à la présenter. Il reste que le dispositif fut assez semblable à celui agencé par Germaine Tillion, pour un petit groupe de Françaises, au camp de Ravensbrück : le carnet où fut notée la partition de l’opérette Le Verfügbar aux enfers, l’humour en moins. Chanter pour survivre, se mettre en scène dans des postures imaginaires qui déréalisent le quotidien tragique. Bricolages d’intellectuels, expérimentaux et intuitifs pour partie, de l’ordre du sauve-qui-peut, du perdu-pour-perdu, qui ont insufflé la vie à quelques-uns de ceux qui allaient sombrer.
sources et remerciements :
► Les informations sur Rémy Gillis ont été généreusement fournies par nos amis belges :
● Christiane Rachez, qui longtemps représenta la Belgique au Comité international de Mauthausen et a bien voulu rassembler ses propres souvenirs, renouer le contact avec le deuxième fils de Rémy Gillis, et être une relectrice exigeante.
● Jeannot Gillis, qui a rédigé pour cette circonstance une note biographique sur son père,
● Jérôme Delnooz, bibliothécaire de Territoires de la mémoire (Liège), a mis à disposition les éléments qu’il a pu collationner,
Qu’ils soient remerciés !
► Peter Kuon , « L’exil ne finissait qu’à la nuit » : Jean Cayrol et les rêves concentrationnaires. Dans Mémoire et exil, Peter Kuon / Danièle Sabbah (éds), KZ Memoria scripta 3., Peter Lang, Frankfurt am Main, 2007
► et les pages consacrées à Jean Cayrol poète (en particulier p. 152-170, 308-324) dans l’ouvrage magistral intitulé L’écriture des revenants. Lectures de témoignages de la déportation politique, 457p., Éditions Kimé, 2013
indications discographiques :
Deux disques microsillon 45 t., 17 cm, édités par l’Amicale de Mauthausen, dans les années cinquante et soixante, contiennent le Chant d’espoir des bagnards de Mauthausen. Le second, intitulé « Le disque du souvenir de la Résistance et de la déportation », date de 1961 ; il contient aussi le Chant des partisans, La Marseillaise, le Chant des marais. Au verso de la pochette est reproduit le poème d’Aragon La rose et le réséda. Un disque plus ancien (date non précisée) est la gravure microsillon d’un 78 tours antérieur. Il propose deux pièces, interprétées par Rémy Gillis : le Chant des marais et le Chant d’espoir des bagnards de Mauthausen.
Car nous marchons ici, mes frères,
Du même pas que les absents
Quand nous tiendrons dans notre main
Le premier morceau de pain blanc
Quand je tiendrai dans mes deux mains
Ton premier visage d’enfant
Quand nous verrons sur les chemins
Passer la fille et la moisson
Alors nous marcherons, mes frères,
Du même pas que les vivants (bis)
Quand nous aurons l’amour le vin
Et le tabac dans nos maisons
Quand nous verrons sur la frontière
Fleurir le premier liseron
Quand nous serons sur la rivière
Le premier pêcheur du printemps
Alors nous marcherons, mes frères,
Du même pas que les vivants (bis)
Quand toute une vie prisonnière
Pourra être mise en chanson
Quand nos vergers pleins de lumière
Auront des fruits dans les saisons
Quand nous mettrons dans nos prières
Les maudits noms de nos prisons
Alors nous marcherons, mes frères
Du même pas que les vivants (bis)