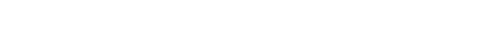Mauthausen (matricule 25 305) – Gusen (matricule 11 787, puis 48 692)
Lazare artiste, pour « réchauffer le monde »
LE FIL DES ANNÉES
Jean Cayrol est né à Bordeaux en 1911 ; il y est mort le 10 février 2005.
Jeunesse
Enfant de la bourgeoisie bordelaise (père chirurgien-dentiste) et basque (par sa mère), il connut – en dépit de la Grande Guerre, marquée pour lui par l’absence du père – une jeunesse fantasque et rêveuse, ponctuée par l’attrait du port, les séjours sur le littoral basque, des désirs d’horizons lointains.
Il manifeste une vocation littéraire précoce – et soulignera plus tard combien peu celle-ci découlait de son milieu familial, où « la lecture était considérée comme un luxe d’oisif ou de malade, aux limites de l’indécence ».
Il rédige ses premiers poèmes dès onze ans, fonde une revue en 1927, Abeilles et Pensées (elle aura quatorze numéros), puis une autre, Les Cahiers du fleuve, qui accueille, entre autres, des textes de Max Jacob.
Il publie un premier recueil de poèmes, Ce n’est pas la mer, en 1935, et, l’année suivante, Le Hollandais volant, marqué par l’influence de Jules Supervielle.
Il a noué des relations dans le monde des lettres : directes avec François Mauriac ou Gaétan Picon, épistolaires avec Joseph Delteil, Eugène Dabit, Henri de Montherlant, Jean Cocteau, Francis Jammes, André Salmon, Valéry Larbaud, Jules Supervielle. En 1939, il écrit aussi à Max Brod pour obtenir une copie du dessin de Kafka La machine à tuer.
Ces années sont aussi celles des études de droit, d’un début de carrière d’avocat. Et du « spectacle extraordinaire » que fut ce soir de 1935 où le violoncelliste Pablo Casals, qui donnait un concert au Grand-Théâtre de Bordeaux, sortit sur les marches et joua pour des immigrés espagnols qui n’avaient pu s’acheter une place. En 1939, il est bibliothécaire à la Chambre de Commerce.
Résistance
Au déclenchement de la guerre, il est mobilisé dans la Marine, comme officier, mais affecté dans un bureau, au renseignement, puis démobilisé en juin 1940 après la défaite militaire. Son frère Pierre le dissuade de rejoindre De Gaulle à Londres, pour participer plutôt à la résistance dans le réseau de la France Libre Confrérie Notre-Dame, du futur colonel Rémy. Son immatriculation est attestée à compter de janvier 1941. Depuis la Chambre de Commerce, il observe les mouvements des sous-marins allemands – dès août 1940, il envoie à Londres un premier dossier sur l’activité du port de Bordeaux.
Il est arrêté en 1941, quand, revenant de Marseille, il franchit illégalement la ligne de démarcation. Il avale ses papiers, est relâché. Il est arrêté une deuxième fois, au printemps 1942, avec le groupe occupé à émettre avec Londres, et relâché. Le 10 juin 1942, dénoncé par un ami, il est arrêté de nouveau et conduit cette fois à la prison de Fresnes (banlieue sud de Paris). Il y séjourne dix mois, y écrit de nombreux poèmes qu’il fait sortir dans des paquets de linge. Certains sont lus sur Radio-Alger (Écrit sur le mur : « …J’appartiens au ciel bleu / qui souffre sur la pierre ») et la plupart publiés, après ceux des années précédentes, dans les Cahiers du sud et Poésie 41, …42, … 43, puis à Neuchâtel (Suisse) par Albert Béguin dans les Cahiers du Rhône, en 1944.
Le 25 mars 1943, il est déporté à Mauthausen, sous le régime « NN », et malgré les interventions des écrivains Louis Aragon, Jean Paulhan et Pierre Drieu la Rochelle (ce dernier, affichant des sympathies pour l’occupant).
Gusen
Jean Cayrol assure, dans une évocation de 1982, avoir abordé le camp « « en fidèle lecteur de Kafka », armé des conseils de survie fournis dans La colonie pénitentiaire. En substance : préserver son apparence, sa mémoire et ses mots ; ne pas penser à l’avenir ni à sa famille ; ne pas jouer à l’absent.
Il est transféré à Gusen le 7 avril et affecté comme manœuvre à la carrière (« je fus, pendant des mois, esclave d’un marteau-piqueur, puis d’une fraiseuse. Ma santé chancelait. Le pus me recouvrait les mains » écrit-il en 1982).
Il est soutenu, nourri et fasciné par le père Gruber (« je suis encore couvert de son sang »). Peu après le supplice de celui-ci, arrive, en avril 1944, le père Jacques (des Carmes d’Avon). Jean Gavard (arrêté en même temps que Jean Cayrol à Bordeaux et avec lui à Gusen) rapporte que le père Jacques surprend le petit groupe des Français en leur disant : « vous avez un grand poète parmi vous ». Et qu’il le pousse à continuer d’écrire, ce qu’il fera, secrètement, sous la table d’un atelier de l’usine Steyr. Ces textes, que Cayrol se refuse à nommer des poèmes, qui semblaient perdus, lui sont restitués, anonymement, en 1955. Il ne les publiera qu’en 1997.
Il écrit les paroles du Chant d’espoir des bagnards de Gusen, que Pierre Serge Choumoff se souvient avoir entendues, portées par la musique composée par le détenu belge Rémy Gillis. Ce chant est depuis lors, en France du moins, quelque chose comme l’hymne des déportés de Mauthausen.
Le sort improbable de rescapé
À son retour à Bordeaux, son père ne le reconnaît pas. Mauriac lui dit : « Jean, vous n’êtes plus de notre monde ».
Il monte à Paris, se lie, via le Comité national des écrivains, à Jean Marcenac, Guillevic, Aragon, Éluard. En 1946, il publie Poèmes de la nuit et du brouillard, textes écrits pour la plupart depuis son retour, et Larmes publiques, constitué de trois longs « chants funèbres » (datés de juin et juillet 1945) en mémoire de son frère Pierre mort à Ellrich, du père Gruber, du père Jacques (mort à Linz le 2 juin 1945).
Ces années sont celles où il cherche la vie comme le malade l’oxygène (« je demeurais dans un trou d’air »). Il s’essaie au roman, écrit Je vivrai l’amour des autres – qui obtient le Prix Renaudot en 1947. À partir de 1949, il travaille aux Éditions du Seuil. En 1950, il publie un premier essai, Lazare parmi nous, qui regroupe deux textes parus en revue : Les Rêves lazaréens (cellulaires, concentrationnaires, […] post-concentrationnaires) et Pour un romanesque lazaréen. Il y profile une esthétique nouvelle, en référence à la figure évangélique de Lazare, puisqu’ « il est évident que nous entrons dans la nuit blanche de l’humanité », et que « nos lendemains n’ont plus qu’une odeur d’abattoir ».
Une décennie encore – éditeur, directeur de revue (Écrire, fondée par lui en 1956), et publiant poèmes et romans – il sera possédé par le sentiment d’une urgence sans issue. Au cœur de ces années, avec le cinéaste Alain Resnais, (et son assistant Chris Marker, les historiens Henri Michel et Olga Wormser, le compositeur Hans Eisler – et Paul Celan pour la traduction allemande –), soudain l’aventure de Nuit et Brouillard : Cayrol, à qui Resnais a demandé d’écrire le texte, d’abord visionne les images, est pris de vertige : « je devins cinglé ».
La pleine vie
C’est le cinéma pourtant – après Muriel, avec Resnais de nouveau (1960), puis Le coup de grâce, avec Claude Durand (1964) – qui, assure-t-il, le ramène à la vie : le « cinéma m’assainit, me remit les pieds sur terre. J’étais sauvé de ces années obscures dans lesquelles j’avais perdu mon espérance. Enfin je déchirai une solitude qui ne m’avait apporté que sa désolation, même dans l’écriture ».
Ce sont, pour le coup, des années très parisiennes. Il investit de plain-pied ses métiers d’éditeur découvreur de talents (jusqu’en 1977), de poète et romancier, essayiste, scénariste et réalisateur de cinéma. Il est membre de l’Académie Goncourt à partir de 1973. Il voyage sur tous les continents. Il s’entoure d’objets d’art (asiatique, plus volontiers, dont il devient un bon connaisseur). Jeanne, qu’il a connue au Seuil, et dont le père est mort à Bergen Belsen, partage sa vie. Ensemble, assure-t-elle, ils ne parlaient pas du passé : « il montrait une nature très gaie, créative, que le camp n’avait pas détruite ».
Jean Cayrol se plaît à souligner qu’il a vécu son époque dans la pleine conscience de ses enjeux: « je portais l’églantine rouge en 1936, la croix de Lorraine en 1940, l’injure à la bouche au passage du général Ridgway, la mort à la boutonnière durant la guerre d’Algérie, la honte au front en pleine guerre du Vietnam » ; il cite encore les massacres français de Malgaches, la Corée, l’affaire de Suez, et avoue : « j’ai même tenu le petit livre rouge de Mao entre mes doigts ».
Lui au naturel si discret, il présente, sur les photos de ces années-là, un visage épanoui, actif, entouré.
Insensiblement plus lointain
Puis il se retire peu à peu, s’absente, quitte Paris (son travail aux Editions du Seuil en 1977, l’Académie Goncourt en 1995) pour une maison de Pujols-sur-Dordogne, puis Bordeaux. Il communique moins. Les toutes dernières années, c’est comme s’il se quittait lui-même, sans douleur semble-t-il, ni angoisse.
Mais il écrit et publie : une très curieuse autobiographie, primesautière et foisonnante, en 1982, sous le titre Il était une fois Jean Cayrol [les citations non référenciées de ce portrait en sont tirées] ; des récits, dans les années 1980 ; des poèmes encore, à plusieurs reprises dans les années 1990 et au-delà (certains restés inédits), et alors que le Seuil a rassemblé en 1988 (et en 800 pages) l’Œuvre poétique.
Il reçoit le Grand Prix national des Lettres en 1984. Une abondante littérature critique lui a été consacrée. L’intelligence parisienne de la littérature contemporaine l’a honoré comme un maître, de Maurice Nadeau à Roland Barthes, de Maurice Blanchot à Philippe Sollers. La critique cinématographique n’est pas en reste.
Une importante exposition titrée Il était une fois Jean Cayrol est produite en 2001 par la Région Aquitaine et présentée à Bordeaux.
L’EMPREINTE DE MAUTHAUSEN : UNE POSTURE SINGULIÈRE
En ce début de l’année 2007, paraissent à Paris deux livres importants pour la connaissance de Jean Cayrol, plus précisément de l’intersection où il se tient – lui qui n’a jamais consacré un récit à son séjour à Gusen, mais qui assigne, à travers l’allégorie de Lazare, l’expression artistique contemporaine à l’horizon post-concentrationnaire. Il s’agit d’abord d’une compilation de l’Œuvre lazaréenne (Paris, Éd. du Seuil, 1 036 pages), regroupant des textes des années 1947-1956 ; et d’une étude universitaire signée Sylvie Lindeperg, titrée « Nuit et Brouillard ». Un film dans l’Histoire (Éd. Odile Jacob, 290 pages). On peut rappeler aussi le petit livre publié en 2003 par Pierre Mertens (Paris, La Renaissance du Livre), qui rouvre l’affaire Adorno : Écrire après Auschwitz ? Semprun, Levi, Cayrol, Kertész. Jean Cayrol, de fait, dans ce quatuor, fait exception, mais il est inclus dans la question.
Des quatre, lui seul est poète – et, sauf les exceptions notables, mais très circonscrites, des recueils du temps de guerre et de déportation – son œuvre poétique fait assaut de légèreté (oiseaux et autres fétiches de vie, quotidienneté et éloge de l’instant, formes aérées et mètres brefs). Une poésie chantante : Jean Gavard se souvient, à Bordeaux avant guerre, et dans les années du retour, avoir entendu Cayrol dire ses textes, les faire sonner. Au détour d’une préface à un recueil de 1955, Jean Cayrol prétend à une « poésie sans cadavres ». Ou, dans cet aphorisme de 1985 : « un poème n’a pas de mémoire ». Cependant, les affleurements et récurrences du séjour concentrationnaire sont disséminés dans ses vers, et cela sur la production d’un demi-siècle – brouillant donc le découpage chronologique. Faut-il des exemples ? D’un texte titré Proverbes de salon, paru en 1950, le premier distique est : « Choisissez une belle carrière / dans le granit ». En 1994, dans D’une voix céleste, ce remugle de Gusen : « C’était la joie des vacances d’été / et les enfants jouaient contre des flots râleurs / et moi je m’enfonçais dans les camps de l’horreur. / Je mangeais la soupe des chiens, je souriais ». Et que penser de l’ « oubli » où tomba quarante-deux ans, jusqu’en 1997 où il est « retrouvé par hasard », le précieux recueil écrit à Gusen (et entre ses mains depuis 1955), publié sous le titre Alerte aux ombres. 1944-1945 ? Peut-on tout à fait croire qu’il était alors – l’année de Nuit et Brouillard, et quelques années après que les premiers textes lazaréens eurent été honorés par un prix littéraire – « conseillé aux survivants d’oublier, de se taire » ?
Les proses, récits et essais lazaréens – incluant le texte de Nuit et Brouillard, et auxquels on peut rattacher le synopsis et les dialogues de Muriel ou le temps d’un retour (absents de l’édition 2007) – témoignent d’un état psychophysiologique directement lié au séjour à Gusen : le rapport aux vivants et aux objets, l’articulation de l’instant et des traumas du souvenir, initient, au plan esthétique, l’école du « Nouveau Roman », auquel se rattachent Je vivrai l’amour des autres et Les corps étrangers (1959). La posture fait sensation, intimidante et admise comme matricielle par beaucoup. Pour Cayrol, catholique fervent, c’est aussi une crise spirituelle qui se reflète dans ces textes : la figure de Lazare « celui qui se relève, celui qui revient du royaume des ombres » et les amples et sombres « chants funèbres » écrits pour les mânes de Pierre, du père Gruber et du père Jacques, contrastent avec, les mêmes années, le défi de légèreté de la plupart des poèmes. De manière analogue, le texte autobiographique de 1982, de structure kaléidoscopique et de ton enjoué, contient un très curieux chapitre, de quelques pages, titré « L’âge d’or du concentrationnat » où, en une écriture crispée, sont consignés des fragments de souvenir de Gusen, en séquences lapidaires – et numérotés ! Quant à l’implication de Jean Cayrol dans Nuit et Brouillard, qui fut douloureuse, et comme doublement contrainte (par la pression de Resnais, par celle du devoir), si elle produit un texte magistral (servi par la voix sans affect du comédien Michel Bouquet) inclus aujourd’hui au cœur de la mémoire culturelle des camps, on soulignera que le rescapé de Gusen y a visé l’universel du « monstre concentrationnaire ». La concision elliptique requise, accentuée par le découpage rythmique réalisé avec l’aide de Chris Marker (autre distanciation), voyons-la aussi comme un prodigieux effort sur soi, une ascèse.
Dans la vie comme dans l’œuvre, quelle est la part congrue de la mémoire ? L’exemple de Jean Cayrol montre, loin des schémas connus, la complexité de cette question. De quelle mémoire parle-t-on ? Celle du corps ? « Je possède un corps assez tuméfié, et parler me donne parfois la nausée ». Celle dont l’écriture est irriguée ? Kafka, qui le hante et qu’il a connu par Jean Carrigue, son premier traducteur en français, lui fournit sans doute l’exemple de ce que l’écriture doit à la nuit ; mais, contrairement à Kafka, les forces de la vie et de l’espérance l’emportent en lui, par volonté ou par instinct. Au point qu’il lui fallut, au cœur même des années de l’impossible retour, dévitaliser les liens humains si forts noués à Gusen, ceux dont tous les rescapés – tous – assurent qu’ils leur doivent d’avoir survécu. Mais, se souvient Pierre Serge Choumoff, Jean Cayrol ne pouvait pas accepter que la vie fût ainsi faite de souvenirs tissés de la « comptabilité macabre » des jours. Dans De la mort à la vie (paru dans la revue Esprit en 1949), il écrit : « on ne peut pas faire une Amicale des Sept-Douleurs, une Amicale de la Croix en dehors de celle de l’Église ; on ne peut pas se réunir pour échanger ses propres plaies comme des timbres-poste ; les souvenirs sont intransmissibles ». La dureté du ton est celle des années terribles ; mais un demi-siècle durant, la règle de vie et d’artiste fut inchangée.
Daniel Simon