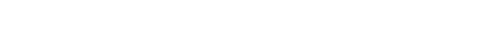Intervention de Daniel Simon, président de l’Amicale de Mauthausen,
au Congrès de Dachau, 3 juillet 2010
Puisque tous les rescapés des camps ont exprimé l’exigence et le souci de transmettre, il leur faut bien accepter que les générations qui les suivent se soient approprié quelque chose de ce passé, et que nous puissions parler ensemble. Merci de nous y inviter. Nous le faisons avec humilité et loyauté, mais portés par des convictions fortes.
Il va de soi – je le dis pour n’y plus revenir – que les productions de la science historique sont essentielles, y compris pour nourrir et parfois relativiser les postures mémorielles. Mais je prétends que la mémoire des camps a un avenir. Je tenterai d’éclairer cette conviction en me limitant à observer la part qu’y tient l’émotion.
L’émotion du « témoin ». Je pense d’abord au lieu où nous sommes. Avec le Fort de Romainville, Royallieu fut le seul camp d’internement sous autorité allemande en France. Mais Compiègne n’est pas Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Auschwitz. La mémoire de Royallieu, camp de transit, dans la tête des rescapés des camps, est entre celle des geôles de la Gestapo et celle de Dachau ou Buchenwald : statut difficile. Je me souviens de l’émotion positive, pas une nostalgie, tout de même pas, pas une exaltation, mais comme une ivresse difficile à faire admettre, avec laquelle mon père évoquait son séjour ici de quelques semaines, exactement pour les raisons que retraçait le général Saint Macary, alors président de notre Amicale, quand, il y a une dizaine d’années, il contribuait avec passion à la conception de ce mémorial :
« Loin des policiers et des interrogatoires, loin des dangers de la torture et de la trahison… vivre à Compiègne, […] c’est faire du sport, accéder à des lieux de culte, se réunir avec les amis retrouvés […], nouer des contacts avec des hommes qu’on ignorait et qu’on aurait toujours ignorés, découvrir la richesse du monde des résistants et des otages, discourir sans fin, refaire la France et le monde, dans une sorte d’ivresse de liberté et de fraternité […] Vivre à Compiègne, cela peut ressembler à du bonheur. Mais un bonheur si précaire et si fragile… car il fallait partir de Compiègne. […] Ce futur, qui aurait pu l’imaginer ? »
Ne pas se faire une représentation simpliste, univoque, de l’émotion qui attache les rescapés au souvenir du camp. Les effluves de la fraternité contrebalancent souvent dans le récit l’évocation des horreurs. Dominique Durand a évoqué l’affleurement rare et contrôlé de l’émotion dans les écrits de son père. À ce que j’ai pu observer souvent, dans les témoignages oraux, in situ ou non, l’émotion est présente toujours, mais jamais prédominante, sauf en des instants où elle submerge la parole, et l’empêche – tandis que l’écrit, par nature, est maîtrisé. On se souvient des séquences si puissantes, dans Shoah de Lanzmann, où les forces obscures de l’émotion produisent la remémoration et donc la connaissance. Ce n’était possible qu’in situ – et nous avons tous observé ce fait, même sur des sites où rien ou presque de visible ne subsiste.
Autrement dit, le témoignage est sous la loi d’une subjectivité et d’une contingence radicales – c’est précisément en quoi il est précieux, et c’est la difficulté qu’il pose à beaucoup d’historiens. C’est pourquoi la connaissance de la société concentrationnaire, du « concentrationnat » (Cayrol), ce ne sont sans doute pas les historiens, ou les historiens seuls, qui sont les mieux à même de la produire. Parmi les démarches fertiles et novatrices, celles d’Anne-Lise Stern ou de Peter Kuon.
L’émotion d’un quidam en charge d’une association de mémoire. Je n’ai bien sûr pas connu les camps, et je ne suis pas historien. Je suis un praticien des activités de mémoire sans autre qualification qu’empirique. Le fait que mon père ait passé 25 mois à Mauthausen ne me confère évidemment aucune autorité particulière. Le poids exact de ce qui m’attache à son souvenir en tout cela, je le perçois mal. Ce que je crois pouvoir en dire, c’est que je ne suis pas porteur, en tout cas consciemment, d’une mémoire traumatique. C’est ce qui me permet d’agir dans le collectif. Je suis frappé de constater, parfois, chez d’autres descendants de déportés, l’évidence d’un traumatisme, et l’enfermement obsessionnel dans le deuil d’un père mort au camp, à peine connu, ou pas connu du tout. J’ai en tête deux cas extraordinairement forts, d’hommes de mon âge avec lesquels il n’est pas possible de travailler, tant ils auront été prisonniers, leur vie durant, de ce passé d’avant leur propre existence. Sous la domination de l’émotion inhibitrice. Moi je me sens libre dans le travail auquel je contribue, libre même du souvenir de mon père, et sans savoir précisément à quoi attribuer cette chance, j’en rends grâce à la relation qu’il sut créer en moi, sans peut-être l’avoir lui-même calculé, avec cette réalité qu’il traversa, le parcours d’un déporté, puis celui d’un ancien déporté. Libre : est-ce à dire sans émotion ? Certes pas, ne serait-ce que la passion qui me porte.
Mémoire / Histoire : est-ce la part de l’émotion qui sépare les deux démarches ? Sur les camps, il n’est pas de discours hors sol possible ni tolérable, jamais, de discours qui n’implique pas un contexte personnel ou social. Et cela pour très longtemps encore, je crois. Parce qu’évidemment la blessure est profonde, en chacun des rescapés, mais au-delà : ce sont les fondements mêmes de la civilisation qui ont été chamboulés, et le point d’ancrage que constituent les camps pour observer le monde demeure pour longtemps valide. La mémoire des camps est dans notre patrimoine collectif. Il est facile d’étayer cette affirmation – je m’en dispenserai ici. Or la mémoire implique les affects et l’interlocution, le théâtre des subjectivités. Il me semble aisé de montrer que le discours historique lui-même n’est nullement exempt, certes à doses ou sous des apparences plus indétectables, de subjectivité et de partis-pris.
Il est d’ailleurs des historiens qui en appellent à l’émotion dans leur stratégie (Michelet), et d’autres (tous ?) ne cachent pas leurs a priori idéologiques (historiens des révolutions française ou russe, de Vichy, de la décolonisation, de toutes les questions encore chaudes).
Il est aussi quelques historiens du système concentrationnaire qui, par défiance à l’égard des affects et dans la crainte sans doute qu’ils ne décrédibilisent la posture de l’historien, s’imposent une incroyable froideur, jusqu’au cynisme. Une histoire du système concentrationnaire nazi qui repousse tous les affects est peut-être possible, mais pas une histoire de la déportation : si l’on ne considère pas les hommes, de quoi traite-t-on ?
Le titre de notre rencontre suggère une chronologie et un processus, dont l’Histoire serait le terme, l’apaisement. Je conteste cette représentation. Il suggère aussi un basculement, comme si l’histoire était dégagée des affects, et comme si l’émotion était une préhistoire de la connaissance. Or les deux ne sont pas du même registre, pas en continuité, pas un flux de l’une vers l’autre.
Pierre Saint Macary proposait de classer comme suit les formes prises par la mémoire du camp depuis 1945. Elle fut, disait-il : souffrante, puis militante, et finalement en quête d’un savoir historique, se livrant aux historiens comme à sa dernière demeure. Si probablement l’histoire de la mémoire dans le demi-siècle qui a suivi peut être retracée ainsi, je doute que ces états successifs définissent vraiment la relation qu’un rescapé des camps a entretenue avec sa propre histoire. Quoi qu’il en soit, ceci ne définit nullement les attitudes mémorielles que nous mettons en œuvre aujourd’hui – en particulier, vis-à-vis des historiens.
La mémoire des camps m’apparaît plutôt constituée toujours de quatre polarités : elle comporte une part d’émotion, elle est sensible. Nous avons un lien exigeant avec les sites, les personnes, les dates. Une douleur, une effusion, parfois une exaltation. Nous sommes des veilleurs ombrageux.
Notre mémoire est aussi un besoin d’histoire : il nous faut une connaissance de ce que fut le camp capable de pallier les approximations et les lacunes des témoignages et tenant à distance les affects et les singularités pour saisir le système. Quelques-uns parmi nous ont accompli un travail d’historien, mais celui-ci est plus souvent extérieur à nous – condition usuelle d’une démarche scientifique. Et il arrive que la vérité historique dérange les représentations dont nous sommes porteurs.
La mémoire du camp est encore un poste de vigie, un ancrage idéologique pour déchiffrer le monde. Chacun d’entre nous y puise des leçons essentielles, pour dénoncer sans répit l’ombre d’une menace sur les libertés, sur l’égalité entre tous les hommes. Notre mémoire est vigilance et combat.
La quatrième dimension de la mémoire, convergence des trois autres mais les dépassant, disons la culturelle. Elle empêche la sclérose et l’instrumentalisation du souvenir : par celui qui céderait à la fascination de l’horreur, par le maniaque s’enfermant dans l’érudition statistique, par le militant qui s’en ferait une dignité usurpée. Elle est une action citoyenne ouverte, invente des représentations et des gestes capables d’interpeller et d’impliquer nos semblables.
C’est en quoi, selon moi, nous ne sommes pas en train de passer la main aux historiens. D’ailleurs, les activités mémorielles ne sont pas leur domaine, et certains ont pour elles un dédain visible. La démarche scientifique leur interdit de céder aux affects, aux convictions personnelles, aux contingences sociales. Si nous leur confions le champ des activités mémorielles, ce sera vite un désert – et nous aurons perdu la mémoire.
L’émotion, outil dévoyé de connaissance. Trois exemples authentiques et récents :
Deux enfants sont nés à Mauthausen. Les deux enfants, et les deux femmes, sont vivants, et se sont retrouvés il y a peu de temps sur le site du camp. Imaginez ce moment ! Vidéo bien entendu, et exploitation de cette séquence dans des collèges autrichiens, jugée efficace par les autorités ministérielles en charge de la mémoire… Après quelle évaluation réelle et responsable ? De l’émotion, sans aucun doute, mais en quoi cet épisode est-il représentatif, constitutif de la réalité du camp, en quoi peut-il être un levier servant la connaissance ?
Autre exemple, fameux, et dont l’aberration restera dans les annales. Par décret politique, la prise en charge, par un enfant de 8-10 ans, du nom, du destin et de la mémoire d’une enfant juif assassiné… Ni le rapport à l’histoire ni le rapport à la mémoire ne fonctionnent ainsi. Dans une œuvre du grand dramaturge polonais Kantor (La classe morte), des vieillards portent sur le dos l’enfant qu’ils furent, sous la forme d’une poupée – mais non pas un enfant un autre enfant, ou bien c’est dans la littérature enfantine, et il s’agit du déploiement infiniment ouvert de l’imaginaire (identification par la fiction à des destins extérieurs à soi), pas dans la prison du destin clos sur le fait avéré d’une extermination qui a eu lieu ! Émotion stérile et destructrice.
Troisième exemple : un déporté pourtant aguerri à l’accompagnement des scolaires, accueille un groupe à Mauthausen, camp pourvu d’une chambre à gaz, y fait entrer les élèves et ferme la porte – « pour qu’ils se rendent compte… » ! Analyse : d’une part, il outrepasse sa fonction de « témoin » (il n’a pas été témoin de ça, ne fait rien partager) ; d’autre part, il produit une angoisse et des émotions violentes, en apprenti sorcier, hors de tout dispositif pédagogique concerté – et au retour, je laisse imaginer les protestations des parents et l’émoi de l’Inspection académique qui proclame que c’en sera fini des voyages de mémoire…
Repli sur les manuels d’histoire… ? À trop se méfier de l’émotion, quelle distance veut-on créer ? Ne mesure-ton pas que celle-ci est infinie, infranchissable, que la société du camp nous est essentiellement inconnaissable, si l’on admet qu’il n’est de connaissance que celle qui donne de quelque façon prise sur le réel, maîtrise, appropriation, investissement imaginaire ?
Toutefois, et précisément, le réel nous est si souvent servi aujourd’hui sur le mode d’affects sans contexte ni signification ni voie d’appropriation – ainsi dans les trois cas que je viens d’évoquer – qu’il est des motifs sérieux de tenir en respect les émotions brutes et les impacts virtuels. Appréhender les camps, c’est entrer dans l’arène idéologique, sociopolitique, éthique. Le passé, mais aussi les leçons du passé, le pouvoir d’éveil des sites, les enjeux de leur préservation et les moyens de leur éloquence, et surtout le monde qui est nôtre. Toutes les sciences sociales sur le chantier. Pas l’histoire seule.