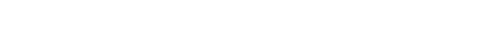film de Gerald Harringer et Johannes Pröll,
Autriche 2021, 69 min., sous-titrage anglais
Ce film, financé par le Memorial Gusen (Gedenkdienstkommitee) est l’œuvre de deux réalisateurs nés à Linz. Il a été présenté en première mondiale le 1er juin 2021 dans le cadre du festival international du film Crossing Europe à Linz. L’Amicale a pu en visionner une copie grâce à Guy Dockendorf, qui l’a découvert en tant que membre du jury du prix Hans Maršálek. Pour l’heure, nous n’avons aucune information sur une éventuelle version sous-titrée en français ni sur les modalités de sa diffusion future.
La trame de Survivre à Gusen suit les témoignages de trois survivants de Gusen : Karl Littner (né à Oswiecim, Auschwitz en allemand, en 1924), Stanisław Leszczyński (né à Łódź 1922 et décédé en 2017) – qui fut vice-président du CIM – et Dušan Stefančič (né en Slovénie en 1927) qui présida le CIM de 2007 à 2011. Ils n’apparaissent à l’écran que rarement, sur des images filmées respectivement en 2014, 2013 et 2017. Leurs propos, extraits surtout d’ouvrages qu’ils ont publiés, sont portés par la voix off des comédiens Maria Hofstätter et Peter Simonischek. S’ils constituent le fil conducteur de la narration, celle-ci progresse également par l’apport d’autres témoignages, de natures diverses : le registre d’un poste de gendarmerie, une interview de Martha Gammer, une chronique paroissiale, et bien d’autres. Aucune indication, par exemple sous forme de texte incrusté, ne vient nous renseigner sur leur statut ni leur source, ils se mêlent avec les voix toujours alternées des mêmes narrateurs afin que rien ne s’insinue entre les faits terribles évoqués et nous, rien sinon le silence. Vers le milieu du film, ces voix changent même de façon intermittente complètement de statut et expliquent, renseignent sur Gusen et son histoire, chiffres à l’appui : mais sans rupture de ton, avec le même parti-pris de la sélection, de la non-exhaustivité. Il faut attendre le générique final pour savoir d’où viennent les propos entendus, découvrir par exemple – si l’on n’est pas autrichien surtout – que c’est avec le président Alexander van der Bellen que Dušan Stefančič dialogue dans telle séquence et même le nom de deux des trois survivants au centre du film ! Une figure de la diversité détruite ?
On le comprend : Survivre à Gusen s’affirme d’emblée comme une œuvre cinématographique avec les ambitions qui en découlent, à l’écart des codes et souvent des travers de maints « documentaires historiques ». Ici, pas de commentaire envahissant (ni a fortiori dramatisant) mais la voix égale des narrateurs qui instaure son rythme obstiné, presque envoûtant, à l’image de celui du bruit du train. Des voix, surtout, qui laissent tout leur espace aux silences – véritable composante du discours filmique – et bien sûr aux images.
Les plans tournés avec des drones magistralement maîtrisés occupent une part majeure du film et particulièrement de sa première partie où nous suivons le convoi qui conduit en janvier 1945 Karl Littner d’Auschwitz à Mauthausen (nous ne saurons rien d’autre sur ce qui a précédé ce transfert ni sur son contexte précis). Nous découvrons les paysages enneigés en de longs plans graphiques, d’une beauté qu’on serait tenté de dire glacée ; ils subjuguent autant qu’ils troublent, voire dérangent tant est forte la dissonance entre cette somptuosité et les événements qui nous sont contés. La caméra évolue sans heurts, parfois s’immobilise à la verticale, parfois embrasse des horizons vastes et vides que raye la voie ferrée, parfois nous place au surplomb des rails comme si nous étions juchés sur la motrice. Aucune suspicion d’une quelconque volonté de reconstitution déplacée et les images n’ont évidemment pas une fonction platement illustrative. Le wagon qui transporte les déportés est évoqué en une image quasiment abstraite : l’intérieur d’un wagon de marchandise immobile aux parois de métal, comme écartelé par un objectif grand angulaire ; seul mouvement, celui de nuages qui avancent lentement. Sur le trajet, le long des voies, les caténaires sont bien visibles, la motrice aperçue dans le paysage ne produit pas de vapeur et la gare de Mauthausen est bien celle d’aujourd’hui – sans que cela soit en rien brutalement disruptif : le traitement de l’image et du son réunit le passé et le présent pour laisser sa place entière à l’émotion. La couleur se fait à peine perceptible même si mille nuances nous écartent du noir et blanc. De plus le choix des heures de tournage (et parfois d’une franche sous-exposition) instaure une atmosphère crépusculaire faisant écho aux propos entendus. Ces paysages ouatés, ces ciels bas qui limitent souvent l’horizon et vers où glisse le drone créent lentement une sorte d’envoûtement ouaté, sorte de caisse de résonance aux témoignages qui se suivent, portés par une voix qui s’efface de longues secondes, voire dizaines de secondes, laissant l’image se déployer dans toute sa force, nous laissant le temps de nous y immerger. Une musique originale et des sons, très efficaces eux aussi, habitent le plus souvent ces silences. Ainsi le son flûté du vent qui balaie le ciel se mêle à la musique. Celle-ci, faite de nappes sonores souvent grinçantes, accompagne avec discrétion l’émotion suscitée ; s’y mêlent des sons étouffés d’apparence réaliste (aboiements, choc d’outils) dont on ne sait s’ils sont naturels ou générés par les musiciens. Comme pour l’image, pas de redondance simpliste : lorsque, en rupture avec l’abstraction de l’harmonie à l’œuvre, une mélodie semble soudain sourdre à l’arrière-plan, sa justification ne sera perceptible qu’un long moment plus tard quand sera évoquée la composition de chansons dans le camp – une forme de résistance.
La quasi-absence d’images d’archives ne surprendra pas dans un tel projet. Les exceptions sont révélatrices de la démarche des réalisateurs. Alors que le « documentaire type » y recourt systématiquement pour « illustrer » les propos des interviewés ou les explications du narrateur, le document historique sera ici isolé de tout discours parasite. C’est ainsi qu’une photo produit sans doute un des moments les plus saisissants du film : celle du camp tel que le découvrent les Américains en mai 1945. L’image apparaît très lentement après un écran noir de 8 secondes et demeure à l’écran douze secondes – c’est très long ! –, dans un silence total, plein cadre, sans zoom soulignant un détail ; puis elle disparaît d’un seul coup ; suit une vingtaine de secondes d’écran noir. L’effet est saisissant. Aucune suggestion, aucune directive explicite de lecture à l’endroit du spectateur. Et le temps de regarder, de se confronter à l’irregardable.
Cette austérité, cette approche radicalement respectueuse du spectateur ne signifient évidemment pas une absence, un effacement du point de vue des auteurs ; elles sont sans doute justement le moyen le plus sûr de nous faire partager leur effroi devant les faits dont ils rendent compte. Et si d’aucuns pourraient percevoir cette sobriété presque millimétrée du propos comme une forme de maniérisme, voire la suspecter d’emphase dans la retenue, il nous paraît qu’au contraire elle ne fait qu’aiguiser la force du propos.
Ce film est d’ailleurs riche d’un contenu informatif dense, porté notamment une fois encore par le recours aux drones. Par exemple, sans l’ajout d’un seul mot, la superposition par étapes des lotissements de pavillons contemporains sur l’image d’une vue aérienne du camp de Gusen vaut tous les commentaires ; et le lent survol qui suit de ces maisons, au ras des toits, survol qui s’achève par le surgissement soudain du mur de béton brut portant l’inscription « MEMORIAL » vaut toute expression d’incompréhension ou d’anathème.
On pourra encore admirer cette exploitation si parlante des drones lorsque la vue captée par la caméra se superpose à une autre image d’archive du Jourhaus puis de la place d’appel. La précision du drone qui arrête son vol au point précis et unique où la superposition est possible apparaît stupéfiante !
Vers le milieu du film, des plans colorés font une apparition : ce sont des archives d’interviews de Dušan Stefančič. Mais les couleurs s’effacent lorsque nous entrons dans l’évocation des tunnels de Bergkristall. Par ailleurs, le film s’ouvre et se clôt sur des plans tournés avec Karl Littner en Californie : images d’une vie retrouvée et qui a pu se refonder pour de nombreuses décennies. Comme un écho à ces quelques évocations de gestes fraternels présentes dans le film. Il s’ouvre sur un plan fixe d’une minute et demie : des vagues (un seul plan fixe d’un drone stationnaire) qui lèchent le sable sur la plage de Santa Barbara : comme un ressassement ? une figure du temps qui efface ? ou du travail jamais fini des vagues qui révèlent le sable en se retirant ?